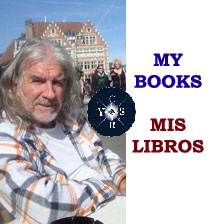 |
BIZANTIUM |
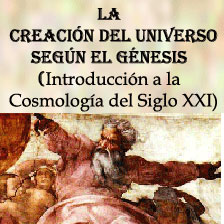 |
Louis Brehier. Le monde byzantin :Vie et mort de ByzanceLIVRE DEUXIÈME. L’EMPIRE ROMAIN HELLÉNIQUEChapitre III.Le déclin et la chute (1057-1204)
La période qui précède l’avènement
définitif de la dynastie des Comnènes est remplie par la lutte acharnée entre
le gouvernement civil du Palais et les chefs d’armée que les événements de 1057
portèrent au pouvoir, mais qui ne surent pas le conserver. De cette rivalité
résultèrent des troubles incessants qui désolèrent l’Empire jusqu’à la victoire
définitive de l’aristocratie militaire avec Alexis Comnène et aboutirent à son
démembrement par la nouvelle ruée des peuples belliqueux, Turcs, Petchenègues,
Normands, qui l’assaillirent sur toutes ses frontières dans la deuxième moitié
du xie siècle.
Ce démembrement eut lieu en deux
étapes : jusqu’à la bataille de Mantzikert (1071), perte des possessions
extérieures, Arménie, Mésopotamie, Italie ; de 1071 à 1081, invasion de
l’Asie Mineure et de la Syrie impériale, violation de la frontière du Danube.
Isaac Comnène. — La maison des
Comnènes, qui arrivait pour la première fois au pouvoir avec Isaac, était
originaire d’un village des environs d’Andrinople. Le père d’Isaac,
Manuel dit Erotikos, se signala sous Basile II par sa belle défense de Nicée
contre Bardas Skléros (978) . Il acquit plus tard de
grands biens en Asie Mineure, ce qui fit de lui et de ses deux fils, Isaac et
Jean, des représentants qualifiés de l’aristocratie militaire .
La victoire d’Isaac Comnène était celle de
cette aristocratie et allait rendre à l’armée sa place dans l’État. Pour bien
marquer le changement de régime, le nouveau basileus se fit représenter sur ses
monnaies le sabre à la main , distribua des
récompenses à tous ses compagnons d’armes et combla de faveurs tous ceux qui
l’avaient aidé à monter sur le trône, notamment Kéroularios, Psellos,
Constantin Lichoudès . Et cependant Isaac ne
conserva le pouvoir que deux ans et trois mois à peine (1er septembre 1057 - 25 décembre 1059) et fut obligé d’abdiquer.
Ce prince, qui avait été accueilli par le
peuple avec un véritable enthousiasme, ne tarda pas à se rendre impopulaire . La principale difficulté
à laquelle il se heurta était l’épuisement du trésor, dû aux prodigalités de
Constantin Monomaque. Cette pénurie d’argent compromettait la défense de
l’Empire, d’où la fiscalité d’Isaac, qui révoqua sans ménagement un grand nombre
de donations ou d’aliénations de terres et n’épargna ni le Sénat, ni le peuple,
ni les monastères, ni même l’armée . II se rendit ainsi
odieux à tous et sa conduite vis-à-vis du patriarche lui aliéna même le clergé.
Au début de son règne il avait accordé à Michel Kéroularios la collation des
principaux offices de l’église Sainte-Sophie, que le patriarche avait en vain
demandée à Théodora et à Michel VI .
Fort de la faveur impériale, Michel
prétendit exercer une action sur la politique d’Isaac Comnène, mais ses
conseils furent accueillis froidement d’abord, puis repoussés sans
aménité . Il en résulta bientôt
entre l’empereur et le patriarche une violente hostilité. Kéroularios se laissa
aller à des paroles menaçantes contre Isaac et, comme pour le braver, se mit à
porter les souliers teints en pourpre, insigne de la dignité impériale, en
disant que c’était là un privilège de l’ancien sacerdoce . En réalité cette
usurpation des insignes de l’Empire devait être interprétée à Byzance comme la
première manifestation d’une révolte . Isaac Comnène ne
devait pas s’y tromper et le 7 novembre 1059 il faisait arrêter le patriarche
par les Varanges. Conduit d’abord à Proconnèse, Kéroularios fut ensuite
emprisonné dans l’île d’Imbros et Comnène s’efforça d’obtenir son abdication,
mais le patriarche repoussa la demande d’une délégation de métropolites qui lui
fut envoyée à cet effet . L’empereur résolut
alors de le déposer et réunit un tribunal, non à Constantinople, mais dans une
ville de Thrace ; il était composé d’évêques et de dignitaires comme Psellos,
qui, malgré les rapports d’amitié qu’il avait avec le patriarche, fut chargé du
discours d’accusation . Mais Kéroularios ne
devait pas comparaître devant ses juges. Extrait de sa prison d’Imbros, il fut
jeté sur un navire qui fut entraîné par les courants vers les Dardanelles et
dut faire relâche à Madyte. Brisé par les émotions et les mauvais traitements,
Kéroularios mourut entre les bras de l’archevêque de Madyte qui lui avait manifesté
sa vénération .
A peine sa mort fut-elle connue que celui
que Psellos avait accusé de tous les crimes fut considéré comme un saint et
Isaac Comnène crut prudent de le faire ensevelir en grande pompe au monastère
même où il avait été arrêté et d’aller témoigner sa douleur sur son
tombeau . Peu de temps après, le
basileus tombait malade et, après avoir créé patriarche Constantin
Lichoudès , il abdiquait l’Empire
et, sur le refus de son frère, le curopalate Jean, il désignait son compagnon
d’armes Constantin Doukas comme son successeur .
Constantin Doukas. — Le nouveau
basileus sortait aussi d’une lignée de chefs illustres, tels que Panthérios, le
Digénis Acritas de l’épopée , mais tandis que les
Comnènes représentaient la noblesse militaire de province, Doukas appartenait à
l’aristocratie urbaine, et était lié avec les sommités du parti civil
bureaucratique comme Psellos, client de sa famille, dont il fit le précepteur
de son fils Michel et son conseiller intime . Il avait d’ailleurs
épousé en secondes noces une nièce du patriarche Kéroularios, Eudokia Makrembolitissa :
un hommage solennel fut donc rendu à la mémoire du défunt patriarche par son
successeur Constantin Lichoudès, et Psellos, qui n’en n’était pas à une
palinodie près, prononça son éloge funèbre en présence des souverains .
Le règne de Constantin X (25 décembre 1059
- 21 mai 1067) eut donc le caractère d’une réaction contre le gouvernement
militaire de Comnène. Ce fut le triomphe de la bureaucratie et des rhéteurs. On
revit à la direction des affaires le personnel des lettrés dont Constantin
Monomaque avait fait l’expérience, Psellos, le patriarche Constantin Lichoudès,
qui mourut en 1064 et eut pour successeur un autre érudit, Jean Xiphilin,
l’ancien nomophylax, qu’il fallut arracher à la cellule de l’Olympe qu’il
habitait depuis neuf ans . L’éloquence était à
l’ordre du jour et le basileus haranguait lui-même ses sujets et se plaisait à
écouter les plaidoiries des avocats qu’il comblait de faveurs . Il attachait une telle
importance aux études qu’avant d’associer à la couronne son fils Michel, il lui
fit, passer un véritable examen portant sur des questions de droit public . Adversaire de la
noblesse militaire, il ouvrit largement le Sénat aux classes moyennes et y appela
jusqu’à des artisans, au grand mécontentement des archontes, dont plusieurs
complotèrent contre lui et ne furent punis que de la confiscation des
biens . Mais le principal
reproche que lui firent ses contemporains fut d’avoir réduit systématiquement
les dépenses militaires, et nous verrons bientôt quelles furent les
conséquences désastreuses de cette politique . Comme Isaac Comnène,
Doukas trouva la situation financière embarrassée, mais, ne voulant pas créer
de nouveaux impôts, il rétablit la vénalité des charges et pratiqua de larges
économies sur ses dépenses personnelles et sur le budget de l’armée .
En mai 1067, se sentant près de sa fin,
Constantin Doukas régla sa succession en décidant que ses trois fils
régneraient conjointement sous la tutelle de leur mère, à laquelle il fit jurer
de ne pas se remarier . En fait sa régence ne
dura que 7 mois et 20 jours (21 mai - 31 décembre 1067) et, au bout de ce
temps, frappée des dangers de l’Empire, elle épousa, malgré sa promesse et sur
le conseil de son entourage, un représentant de la noblesse militaire, Romain
Diogène, stratège de Triaditza (Sofia), qui possédait de grands biens en Cappadoce
et était très populaire dans l’armée. Très ambitieux, il avait été convaincu
d’avoir voulu usurper le trône et n’avait dû son salut qu’à l’impératrice . Par un vrai coup de
théâtre le conspirateur obtenait la couronne dont la recherche avait failli lui
coûter la vie. On revenait ainsi au régime des princes-époux, mais il fallut
rassurer les trois héritiers légitimes et calmer la garde des Varanges qui voulaient
brûler le Palais avec le couple impérial .
Pas plus que ses prédécesseurs Romain
Diogène n’était de taille à relever l’Empire, dont les finances étaient ruinées
et les armées dénuées du nécessaire. La solde n’étant plus payée, un chef
normand au service de l’Empire, Robert Crispin, envoyé contre les Turcs, fait vivre
ses troupes sur le pays, saisit les caisses impériales puis les biens des
particuliers et bat toutes les armées envoyées contre lui, et, après une
victoire sur les Turcs, finit par rentrer en grâce . Le nouveau basileus
chercha à faire des réformes, mais, d’un caractère très autoritaire, il blessa
Eudokia qui voulait continuer à gouverner l’Empire et, après deux mois de
mariage, le conflit devint tel que Romain alla s’établir avec sa garde au-delà
du Bosphore afin d’organiser une expédition
contre les Turcs.
Situation extérieure. — La crise
intérieure qui a troublé l’Empire entre 1057 et 1071 n’a pas tardé à se
répercuter, sur la situation extérieure. En quatorze ans l’œuvre de la dynastie
macédonienne a été ruinée. A la fin de cette période l’Italie est perdue pour
l’Empire, l’Asie Mineure est envahie, la frontière du Danube est violée ;
privé de ses deux ailes, l’Empire est menacé même dans la péninsule des
Balkans.
En 1059 les Hongrois, qui depuis saint
Étienne (1000-1038) avaient eu les meilleurs rapports avec Byzance , passèrent subitement
le Danube avec des bandes de Petchenègues mais une riposte immédiate d’Isaac
Comnène les contraignit à demander la paix . La défense de la
frontière était encore assurée. Il n’en fut plus de même sous Constantin X qui
laissa prendre Belgrade après un siège de trois mois par le roi de Hongrie
Salomon, en représailles de ravages sur les terres hongroises imputables à des
Bulgares (1064) . Plus grave encore fut,
l’année suivante, l’invasion d’un nouveau peuple, les Oghouz, proches parents
des Turcs Seldjoukides, nomades comme eux au nord de la Caspienne, puis poussés
vers l’ouest par les Comans et poussant eux-mêmes devant eux les Petchenègues . En 1065 ils passèrent
le Danube sur des outres ou des monoxyles, mirent en déroute les troupes de la
frontière, capturèrent deux ducs, dont Nicéphore Botaniatès, le futur basileus,
puis ravagèrent la Macédoine jusqu’à Thessalonique et pénétrèrent même en
Thessalie. Quand ils revinrent, chargés de butin, ils furent harcelés par des
corps bulgares qui en détruisirent une partie, mais, au lieu de lever une armée
contre eux, Constantin X préféra les prendre au service de l’Empire et les
cantonna en Macédoine .
Perte de l’Italie. — Après la
bataille de Civitate, les Normands, étonnés eux-mêmes de leur victoire, étaient
incapables de l’exploiter et ne purent même pas prendre Bénévent . Leurs progrès furent
donc très lents, favorisés d’ailleurs par l’inaction de Byzance
(1054-1056) . Un des légats de 1054,
le chancelier Frédéric de Lorraine, élu pape sous le nom d’Étienne IX, essaya
bien de renouer une alliance avec Constantinople, mais il mourut au moment où
son ambassadeur Didier, abbé du Mont-Cassin, allait quitter l’Italie (février
1058) . Seul Argyros parvint à
Constantinople, mais ce fut pour y trouver Isaac Comnène sur le trône et Kéroularios
en grande faveur : il regagna l’Italie où il mourut en 1068 .
L’alliance entre la papauté et Byzance
avait vécu. Les événements décisifs qui se produisirent alors rendirent son
renouvellement impossible. Tout d’abord en 1057, Robert Guiscard, qui avait
commencé à conquérir la Calabre, est élu chef des Normands après la mort de son
frère Humphroi dont il réunit les possessions aux siennes . En 1058, après la mort
de Pandolf V, Richard d’Aversa s’empare de Capoue, première ville importante
prise par des Normands . Mais l’événement le
plus considérable fut le renversement de la politique pontificale et l’alliance
de la papauté avec les Normands. Le pape réformateur Nicolas II, élu en janvier
1059, eut recours à une troupe de Normands pour expulser de Rome l’élu des
comtes de Tusculum, Benoît X. Il en résulta une réconciliation entre le
Saint-Siège et les conquérants. L’accord fut probablement négocié par Didier,
abbé du Mont-Cassin, et, au concile de Melfi le 23 août 1059, Nicolas II
donnait l’investiture de la principauté de Capoue à Richard, comte d’Aversa, et
celle du duché de Pouille et de Calabre à Robert Guiscard, événement gros de
conséquences, qui assurait des défenseurs au Saint-Siège et un pouvoir légal
aux chefs normands .
Dans les années suivantes les progrès des
Normands s’accentuent. En 1060 Robert Guiscard et Roger s’emparent de Reggio et
de Scilla, victoires qui complètent la conquête de la Calabre . Ce fut seulement alors
que Byzance put réagir. Constantin X envoya une expédition qui put reprendre la
plupart des villes d’Apulie et la Terre d’Otrante pendant que Guiscard aidait
son frère Roger à conquérir la Sicile, mais à son retour en Italie, il reprit
aux Grecs plusieurs des places conquises par eux et réduisit les catapans de
Bari à la défensive . Une offensive
diplomatique de Constantin X ne fut pas plus heureuse : il s’agissait de
remplacer Nicolas II, mort le 27 juillet, par un candidat de la noblesse
romaine, Cadalus, évêque de Parme, qui, par l’intermédiaire du marchand
amalfitain Pantaléon, se serait engagé à renouer avec Byzance et l’empereur
Henri IV. Mais le parti réformateur fit élire à la papauté l’évêque de Lucques
qui prit le nom d’Alexandre II : Cadalus, élu quelques jours après sous le
nom d’Honorius II, ne put se maintenir à Rome .
L’Italie byzantine n’en fut pas moins
disputée pied à pied par les catapans qui soutinrent les révoltes des vassaux
de Robert Guiscard, comme Aboulcharé qui arriva en 1064 avec des renforts et se
mit en rapport avec lesrebelles . En 1066 l’archevêque
de Bari allait demander des secours à Constantinople et, quelques mois plus
tard, un corps de Varanges débarquait à Bari et reprenait Brindisi et Tarente,
perdues pour la deuxième fois par les Normands . Au moment de la mort
de Constantin X, la situation était loin d’être désespérée et la résistance
était forte en Apulie. Ce fut alors que Robert Guiscard, abandonnant la
conquête de la Sicile, réunit toutes ses forces et, après avoir refoulé l’armée
grecque, vint mettre le siège devant Bari le 5 août 1068 : il mit près de
trois ans à s’en emparer (16 avril 1071) et encore grâce aux intelligences
qu’il avait dans la ville . Romain Diogène, occupé
contre les Turcs, n’avait pu secourir efficacement l’Italie perdue désormais
sans retour, mais dans laquelle trois siècles de domination byzantine devaient
laisser une empreinte indélébile. La prise de Palerme par Robert Guiscard (8
janvier 1072) compléta magnifiquement la conquête normande .
L’invasion des Turcs. — En Orient
Constantin X eut de bons rapports avec le calife fatimite et obtint de lui,
moyennant le paiement d’une taxe, des avantages importants pour les chrétiens
de Jérusalem, qui eurent un quartier à eux sous la juridiction du
patriarche . En revanche le même
empereur essaya d’imposer le rite grec aux Arméniens suivant la politique
intolérante pratiquée par Michel Kéroularios . Il fit venir à
Constantinople le nouveau catholikos d’Ani, Khatchig, et le retint trois ans
(1060-7063) en voulant le forcer à lui payer tribut. Ses tentatives pour faire
abandonner aux Arméniens le rite des azymes ne furent pas plus heureuses .
Cette politique était d’autant plus
maladroite que la domination byzantine en Arménie était gravement menacée par
les progrès des Turcs Seldjoukides.Jusque-là ils n’avaient fait que des expéditions
de pillage, désorganisant et ravageant les provinces sans s’y établir, mais la
situation changea lorsque Toghroul fut devenu le maître à Bagdad, eut fait le
pèlerinage de La Mecque (1055) et fut considéré par tous les Musulmans comme le
champion de la doctrine sunnite ou orthodoxe en face des Fatimites
schiites : en 1058 il
sauvait Bagdad qui allait être livrée avec son calife au Fatimite du Caire et
en récompense il était proclamé de nouveau sultan et émir-al-oumârâ
(1059) . Dès lors il reprend la
guerre sainte contre l’Empire affaibli par ses discordes, fait ravager le
territoire arménien et piller le thème impérial de Sébaste (Siwas) .
Toghroul mourut en 1062, mais il légua à
son successeur, Alp-Arslan, son pouvoir et son grand dessein . Le nouveau sultan
attaqua d’abord l’Arménie et s’empara d’Ani, dont il fit massacrer une partie
des habitants, emmena l’autre en captivité à Bagdad (1064) , puis, après des
attaques contre Édesse, dégagée par le duc d’Antioche, un Arménien (1065) , il crut le moment venu
d’attaquer l’Empire à fond et de marcher sur Constantinople après avoir conquis
l’Asie Mineure. Au printemps de 1067 il envahit le Pont et pénétra jusqu’à Césarée
de Cappadoce qu’il ruina, tandis qu’une autre armée turque ravageait la frontière
de Cilicie .
Ce fut alors que Romain Diogène assuma la
défense de l’Empire. Excellent chef de guerre, il disposait malheureusement
d’une armée dont la qualité inférieure était due à la politique néfaste de
Constantin X, troupe de recrues mal exercées et mal armées, appartenant à
toutes les races, Normands, Russes, Bulgares, Arméniens, dépourvues de toute
cohésion .
Malgré ces désavantages, Romain Diogène
réussit à tenir les Turcs en échec pendant trois ans.
Dans une première campagne il les chasse du
Pont, les poursuit avec des troupes d’élite, leur coupe la retraite à Tephrik
(thème de Sébaste) et en massacre un grand nombre. Ralliant le gros de son
armée à Sébaste, il attaque la Syrie musulmane, prend Hiérapolis (Mabough) et
remporte une nouvelle victoire devant cette ville (20 novembre 1069), puis
repasse le Taurus sans avoir pu empêcher les Turcs de prendre Amorium en
Galatie . En 1069 il dégage la
Cappadoce envahie, mais ses opérations sont gênées par la révolte du chef
normand Crispin et, pendant qu’il marche vers le lac de Van, son lieutenant,
Philarète, se fait battre par les Turcs qui reviennent en Cappadoce, poussent
jusqu’en Lycaonie et prennent Iconium, mais Romain les force à battre en
retraite . En 1070 il laissa
Manuel Comnène, fils aîné du curopalate, diriger les opérations. Battu et pris
près de Sébaste, Manuel négocia avec son vainqueur, Khroudj, révolté contre le
sultan, et revint avec lui à Constantinople, pendant qu’Alp-Arslan assiégeait
Édesse sans pouvoir s’en emparer .
Enfin en 1071 Romain ayant renforcé son
armée résolut de faire un effort suprême. Quittant Constantinople le 13 mars
avec Khroudj et Manuel Comnène, qui mourut en chemin, il marcha au-devant du
sultan par Théodosiopolis prit Mantzikert sur le Haut Euphrate oriental, mais
il affaiblit son armée en envoyant une division soutenir Roussel de Bailleul,
chef des auxiliaires normands, qui cherchait à atteindre le lac de Van. Ce fut
le moment qu’Alp-Arslan choisit pour attaquer l’armée impériale, alors que
Romain, trompé par de faux rapports, le croyait en fuite vers Bagdad. Le 26
août 1071 la bataille de Mantzikert fut pour Byzance une des plus grandes
défaites qu’elle ait subies au cours de son histoire. Après une journée de
combats une fausse manœuvre de Romain, soucieux d’aller défendre son camp, fit
croire à l’armée qu’il s’enfuyait et ce fut une débandade générale qui permit
aux cavaliers turcs de massacrer ou de capturer les fuyards. Le basileus
lui-même, après s’être défendu bravement, fut fait prisonnier .
Conduit devant le sultan, Romain Diogène
fut accueilli avec les plus grands honneurs, mais dut signer un traité par
lequel il s’engageait à payer 1 500 000 pièces d’or pour sa rançon et
un tribut annuel de 360 000 pièces d’or. Un échange de prisonniers fut
prévu et la paix fut conclue pour 50 ans .
Cette défaite devait avoir pour
conséquences la rupture de l’organisation défensive des frontières qui avait
arrêté jusque-là les invasions et, à l’intérieur, la guerre civile qui permit
aux Turcs de s’installer en Asie Mineure .
2. Dix ans d’anarchie et de revers (1071-1081)
En 1071 et 1081 il existe encore des armées
byzantines, mais elles ne sont plus guère occupées qu’à se faire la guerre entre
elles, presque toujours avec l’aide de l’ennemi . Le résultat est la
ruine de la puissance politique et militaire de l’Empire.
La défaite de Romain Diogène, connue à
Constantinople, y provoqua une double révolution. Eudokia rappela d’exil le
César Jean Doukas, frère de Constantin X , et fit prononcer par
le Sénat la déchéance de Romain , mais le César, appréhendant
le retour de celui-ci, gagna la garde impériale, fit proclamer basileus son
neveu Michel Doukas, força Eudokia à entrer dans un monastère et fit exiler aux
îles des Princes Anna Dalassena, la mère des Comnènes, suspecte de relations
avec Romain . Celui-ci, à la
nouvelle de sa déchéance, leva des troupes et occupa Amasée du Pont, où il fut
attaqué et vaincu par Constantin Doukas, deuxième fils du César Jean. Réfugié
dans la forteresse de Tyropoion, il semblait perdu, lorsque l’Arménien
Khatchatour, qu’il avait créé duc d’Antioche, vint à son secours et l’emmena en
Cilicie où il se prépara à résister . Cependant avant de
l’attaquer, le jeune empereur Doukas tenta un accommodement avec lui, mais il
refusa d’abandonner la moindre parcelle du pouvoir . Attaqué par Andronic
Doukas (début de 1072), il fut contraint de s’enfermer dans Adana et capitula à
condition d’avoir la vie sauve, mais le César Jean donna l’ordre de lui crever
les yeux et de le déporter à Proti, où il mourut dans d’horribles souffrances .
Michel VII. — Fils aîné de
Constantin X et d’Eudokia, Michel Doukas se trouva seul maître du pouvoir, mais
son règne, qui dura 6 ans et 2 mois (24 octobre 1071 - 7 janvier 1078), fut
entièrement néfaste et acheva la décomposition de l’Empire. Au lieu du soldat
qu’il eût fallu pour rétablir la situation, Byzance eut à sa tête un lettré, excellent
élève de Psellos, souverain selon son cœur, passionné comme son père pour la
rhétorique, les spéculations philosophiques, la poésie, doué, à en croire son
maître, de toutes les vertus, mais caractère faible, détourné de l’action par
l’éducation qu’il avait reçue, regardé comme insignifiant par ses contemporains . Il laissa donc ses
conseillers gouverner l’Empire sous le contrôle du César Jean. Ce fut d’abord
l’archevêque de Sidé qui lui fit rappeler d’exil les Comnènes , puis l’eunuque
Niképhoritzès, intrigant qui avait laissé les plus mauvais souvenirs à
Antioche, dont il avait été duc sous Constantin X . A peine au pouvoir, il
gagna la faveur du basileus et le détermina à disgracier le César Jean et à
éloigner de lui Psellos . Il attira à lui toute
l’autorité et s’en servit pour s’enrichir en s’emparant du monopole du commerce
des blés et il en fit monter les prix à tel point qu’il s’ensuivit une
véritable famine et que l’empereur, pour qui il prétendait travailler, fut
flétri du surnom de Parapinakès (quart de médimne), cette quantité infime de grains coûtant un sou d’or .
Invasions turques et révoltes. — Cependant,
après leur victoire de Mantzikert, les Turcs se répandaient dans toute l’Asie
Mineure. Alp-Arslan, indigné du traitement infligé à Romain Diogène, se
déclarait son vengeur. Les querelles intestines et les révoltes militaires qui
éclatèrent à Byzance allaient faciliter la conquête de l’Asie, chacun des
partis rivaux prenant des Turcs à son service. On a pu dire que ce furent les
autorités byzantines qui encouragèrent leurs ravages et leur donnèrent un
caractère presque légal . Amenés comme
mercenaires dans toutes les parties de la péninsule d’Anatolie et jusqu’en face
de Constantinople, ils ne tardèrent pas à en être les maîtres sans avoir eu
besoin d’obtenir des cessions territoriales par des traités .
La première révolte fut celle du chef des
auxiliaires normands, Roussel de Bailleul, qui, à la tête de 100 chevaliers,
avait aidé Robert Guiscard et Roger à conquérir la Sicile en 1063 , était entré ensuite au
service de l’Empire et avait pris part à la bataille de Mantzikert . II succéda à Crispin
comme chef des contingents normands et se trouvait en cette qualité dans
l’armée qu’Isaac Comnène, créé domestique des scholes d’Orient , conduisit contre les
Turcs en 1073. Il méditait depuis longtemps l’apostasie et, arrivé à Césarée en
Cappadoce, il saisit le premier prétexte venu pour s’échapper du camp avec ses
troupes, marcha sur Sébaste et tint la campagne pour son compte, pillant et
rançonnant Grecs et Turcs, attirant à lui des aventuriers de toute sorte avec
le projet de se créer une principauté à l’exemple de ses compatriotes
d’Italie . Pendant près d’un an
il tint en respect toutes les forces de l’Empire.
Isaac Comnène en le poursuivant fut fait
prisonnier par un parti de Turcs et, après avoir payé sa rançon, ne put que
battre en retraite sur Constantinople avec son frère Alexis, le futur
empereur . Le César Jean, envoyé
contre le rebelle, fut battu et fait prisonnier au pont de Zompi sur le
Sangarios, non loin d’Amorium. La route de Constantinople était libre :
Roussel, voyant son armée accrue, s’y précipita, mais n’osant se proclamer
basileus, arrivé à Nicomédie, força le César Jean à prendre la couronne en le
menaçant de mort et, continuant sa marche, arriva à Chrysopolis qu’il
incendia . Michel VII effrayé
essaya en vain de négocier avec lui en lui renvoyant sa femme et son fils
restés dans la ville . Alors par un procédé
tout byzantin, il gagna par des subsides le chef turc Artoukh qui, parti de
Cappadoce avec une forte troupe vint surprendre Roussel près de Nicomédie et,
après une bataille qu’il gagna grâce à sa supériorité numérique, fit prisonniers
le chef normand et son empereur .
La partie semblait perdue pour Roussel,
mais sa femme put payer sa rançon et, rassemblant les débris de son armée, il
se réfugia dans le thème des Arméniaques, dont il avait fait le centre de son
gouvernement et qu’il avait eu soin d’épargner, tandis qu’il pillait les
provinces voisines . A bout de ressources,
Michel VII et Niképhoritzès firent une dernière tentative et confièrent le peu
qu’il leur restait de troupes et d’argent au second des Comnènes, Alexis, âgé
de 25 ans, mais déjà populaire. Habile et énergique, le futur basileus rallia à
Amasée les débris d’une troupe d’Alains du Caucase qui avaient été envoyés
contre Roussel et mis en fuite à la première rencontre. Il affaiblit son
adversaire par une guerre d’embuscades et en lui faisant fermer les portes de
toutes les villes. Ayant appris que Roussel avait fait alliance avec un nouvel envahisseur,
le chef turc Toutakh, il obtint de celui-ci, moyennant une grosse somme
d’argent, que le chef normand lui fût livré et il ramena triomphalement à
Constantinople son prisonnier, qui fut jeté dans un cachot et y serait mort de
faim sans l’intervention de son généreux vainqueur .
Au même moment un aventurier arménien,
Philarète, après avoir été au service de l’Empire, avait profilé de la guerre
civile pour former une armée composée d’Arméniens et d’auxiliaires et s’emparer
des places fortes du Taurus en assurant aux populations chrétiennes un refuge
contre les Turcs, mais en refusant toute obéissance à Michel VII . En 1074 ses
possessions s’étendaient du territoire de Mélitène à celui d’Antioche, ville
dont il cherchait à s’emparer et où il avait un fort parti protégé par le
patriarche Émilien. Il crut l’occasion favorable à la mort du duc Tarchaniotès,
et des troubles éclatèrent dans la ville ; mais Niképhoritzès nomma duc
d’Antioche Isaac Comnène, qui expédia le patriarche à Constantinople, parvint à
réprimer l’émeute avec l’aide des garnisons voisines et rétablit la paix .
La tranquillité ne régnait pas davantage
dans les provinces européennes, troublées en 1073-1074 par une nouvelle révolte
des Bulgares, soutenue par le grand joupan serbe Michel Bogislav, qui leur
envoya son fils Constantin Bodin, proclamé à Prizrend tsar des Bulgares.
D’abord vainqueur de l’armée du thème de Bulgarie, Bodin fut battu et pris dans
la plaine de Kossovo ; interné en Syrie, il s’échappa en 1078 avec la
complicité des Vénitiens. L’insurrection bulgare n’en continua pas moins sous
un chef lombard, Longibardopoulos, ancien prisonnier de guerre de Bodin. Il
fallut pour la réprimer l’intervention de Nicéphore Bryenne, qui chassa les
Serbes de Macédoine et, après avoir établi son quartier général à Durazzo, mit
un terme aux incursions continuelles des Croates et fit la chasse aux pirates
normands, qui infestaient l’Adriatique . Mais l’Empire éprouva
de ce côté deux échecs politiques : en 1076 Zvonimir était couronné roi de
Croatie et de Dalmatie à Spalato par deux légats du pape Grégoire VII et en
1078 le même pontife envoyait une couronne royale à Michel Bogislav et lui
décernait le titre de rex Sclavorum .
Révolte générale des armées d’Europe et
d’Asie.
— En 1076, année marquée par une épidémie de peste, par une famine due aux spéculations
de Niképhoritzès et par une nouvelle incursion des Turcs en Asie Mineure, le
mécontentement devint général . La plus grande indiscipline
régnait dans les armées. Pendant la campagne de Nicéphore Bryenne en Bulgarie,
ses troupes, composées d’Allemands, de Normands et de Petchenègues, s’étaient
livrées au pillage le plus éhonté et une partie d’entre elles, le corps des
Petchenègues et l’armée du thème de Paristrion et son duc Nestor, marchèrent
sur Constantinople (1075). Niképhoritzès conjura le danger en achetant les
principaux chefs des mutins et Nestor, à la veille de lui être livré, battit en
retraite .
Mais le ministre favori de Michel VII
continuait à accumuler les fautes et osait s’attaquer au meilleur général de
l’Empire, à Nicéphore Bryenne, qui n’avait à son actif que de loyaux services.
Prévenu par celui-là même qui était chargé de faire une enquête sur ses actes,
Bryenne se révolta et fut proclamé empereur par son armée à Trajanopolis le 3
octobre 1077 . Depuis les révoltes de
Maniakès et de Tornikios, tous les mouvements insurrectionnels étaient partis
d’Asie : ce fut cette fois l’armée d’Occident qui prit l’initiative, mais
elle devança de peu l’armée d’Orient, qui le 10 octobre suivant proclamait
empereur son chef, le domestique des scholes Nicéphore Botaniatès . Au lieu de s’unir
comme en 1057, les deux armées eurent chacune leur prétendant et se disputèrent
l’Empire, circonstance dont Michel VII et son ministre se hâtèrent de profiter
pour essayer de sauver leur pouvoir.
De plus Bryenne se montrait hésitant. Après
avoir battu Basilakès, envoyé pour l’arrêter, il n’osa attaquer lui-même
Constantinople et chargea de cette mission son frère Jean Bryenne, dont les
troupes indisciplinées, arrivées devant les Blachernes, traversèrent la Corne
d’Or et allèrent piller les faubourgs des Sykes. Michel VII n’hésita pas à
délivrer Roussel de Bailleul de sa prison et le mit à la tête des troupes dont
il disposait avec Alexis Comnène et Constantin Doukas, frère du basileus. Jean
Bryenne dut battre en retraite et ce nouveau succès contribua à augmenter le
prestige de Comnène, à qui Michel VII accorda la main d’Irène Doukas,
petite-fille du César Jean . Jusque-là il s’était
toujours opposé à cette union qui réconciliait les Doukas et les Comnènes.
Mais, si la tentative de Bryenne semblait
arrêtée, il n’en fut pas de même de la révolte de l’armée d’Asie. Pour venir à
bout de Nicéphore Botaniatès, Niképhoritzès avait négocié avec les Turcs qui
s’étaient engagés à couper la route de Constantinople au rebelle. Avec une très
grande hardiesse celui-ci partit avec une escorte de 300 hommes et, devançant
le gros de l’armée turque, entra en triomphe à Nicée, d’où il se mit en
relations avec ses émissaires de Constantinople . Ceux-ci agirent
aussitôt et organisèrent un soulèvement qui éclata le 23 mars 1078. Par son
irrésolution Michel VII perdit la partie et, après avoir confié la défense de
son trône à Alexis Comnène, il abdiqua en faveur de son frère Constantin, qui
refusa la couronne et alla porter ses hommages au prétendant. Le 2 avril
Nicéphore Botaniatès entrait à Constantinople et était couronné à Sainte-Sophie
le lendemain . Michel VII était créé
archevêque d’Éphèse et Niképhoritzès interné à l’île d’Oxya, où il expira dans
les tourments .
Cependant Nicéphore Bryenne et l’armée
d’Europe marchaient sur Constantinople et plusieurs propositions d’entente
faites par Botaniatès furent repoussées . Alexis Comnène, rallié
au nouvel empereur et créé nobilissime et domestique des scholes, partit à la
rencontre de Bryenne et mit son armée en déroute à Kalavrya (les
Belles-Fontaines) en Thrace, avec l’aide de trois corps turcs envoyés par le
sultan Soliman. Fait prisonnier, Bryenne fut conduit à Constantinople et confié
à un ancien favori de Michel VII qui le fit aveugler . Reçu avec froideur au
palais, Alexis Comnène dut aller réduire la révolte de Basilakès, l’ancien adversaire
de Bryenne, qui, après avoir levé des troupes, s’était fait proclamer empereur
à Thessalonique. Battu et fait prisonnier, Basilakès fut conduit à
Constantinople et aveuglé . Nicéphore Botaniatès,
qui devait son trône à Alexis, permit qu’il entrât en triomphe dans la voile
impériale et lui conféra le titre de sébaste .
Nicéphore Botaniatès. — Issu de la
famille des Phocas, qui prétendait se rattacher à la gens Fabia, le nouveau basileus avait eu dans l’armée une brillante
carrière et était devenu l’un des premiers chefs de guerre de Byzance . Froid et circonspect,
il aurait pu réussir s’il ne se fût trouvé devant une situation inextricable,
mais pendant son règne très court (7 janvier 1078 - 1er avril 1081)
les révoltes militaires se succédèrent sans interruption et il fut absolument
impuissant à relever l’armée désorganisée par l’indiscipline . Malgré ses deux
favoris slaves, Boril et Germain, Botaniatès se montrait clément pour ses ennemis
de la veille et il alla même jusqu’à
confier une expédition contre les Turcs au frère de Michel VII, un porphyrogénète :
à peine était-il à Chrysopolis que ses soldats le proclamaient empereur et Botaniatès,
qui n’avait aucune force à lui opposer, dut acheter ses principaux officiers,
qui le lui livrèrent : Constantin fut simplement tonsuré et relégué dans
une île de la Propontide .
La situation de l’Empire était d’autant
plus grave qu’il n’y avait pour ainsi dire plus d’armée en Asie Mineure, dont
Nicéphore Botaniatès avait rappelé toutes les garnisons au moment de sa révolte
contre Michel VII. A Antioche le duc du thème, l’Arménien Vaçag Bahlavouni, fut
assassiné ; les Arméniens de la ville firent appel à Philarète qui devint
le maître d’Antioche. Non seulement le basileus ne fit aucun effort pour l’en
chasser, mais, sur le conseil du patriarche Émilien, resté à Constantinople, il
lui confia la défense du Taurus, dont les garnisons impériales furent placées
sous son autorité, et lui donna le titre de curopalate, à condition qu’il se
reconnût son vassal .
Ce fut ensuite la révolte de Nicéphore
Melissenos, beau-frère des Comnènes, avec une armée de mercenaires turcs. Non
seulement il battit l’eunuque Jean envoyé pour l’arrêter, mais il installa ses
Turcs en garnison à Nicée, à Cyzique et dans d’autres villes d’Asie, dont ils
ne purent être délogés plus tard .
Révolte des Comnènes. — Le dénouement
approchait. Le mariage en troisièmes noces de Nicéphore Botaniatès avec
l’impératrice Marie, femme de Michel VII, encore vivant, causa le plus grand
scandale , mais la réprobation
fut plus grande encore lorsqu’on apprit que Botaniatès destinait sa succession
à l’un de ses cousins, au mépris des droits du fils que Marie avait eu de
Michel VII, le jeune Constantin . Avec une très grande
habileté les Comnènes, suspects aux ministres de Nicéphore en raison de leur
popularité dans l’armée, lièrent partie avec l’impératrice qui avait adopté
Alexis comme fils et se déclarèrent les défenseurs de l’héritier légitime .
En réalité ils préparaient leur révolte,
que le récit d’Anne Comnène présente comme une improvisation . Avertis des mauvais
desseins que les ministres de Botaniatès méditaient contre eux, les deux frères
quittèrent Constantinople le 15 février 1081 et gagnèrent Tchorlou, où se
concentraient les troupes qu’Alexis devait conduire contre Cyzique, afin d’en
chasser les Turcs . Là Alexis Comnène fut
proclamé basileus, mais ce fut seulement à la fin de mars qu’il parut devant
Constantinople, dont Nicéphore Melissenos se rapprochait de son côté, tout en
négociant avec son beau-frère le partage de l’Empire . Botaniatès ne disposait
que d’un petit nombre de soldats, mais ce fut cependant grâce à la trahison des
mercenaires allemands qu’Alexis Comnène pénétra dans la ville le 1er avril 1081 . Malgré ses ministres
Nicéphore Botaniatès ne fit aucune résistance et se laissa reléguer dans un
monastère .
La situation n’en était pas moins confuse.
Alexis faisait traîner à dessein les négociations avec Melissenos et ses
soldats pillaient Constantinople comme une ville conquise. Nul ne pouvait
deviner qu’une nouvelle ère commençait pour Byzance.
Situation extérieure en 1081. — Au moment où
le trône échoit à Alexis Comnène, l’Empire a perdu définitivement l’Italie, sa
situation est menacée dans l’ouest de la péninsule des Balkans ; l’Asie Mineure,
la Mésopotamie, l’Arménie lui échappent.
Les Turcs seldjoukides sont de plus en plus
nombreux en Asie Mineure, mais, comme l’a montré Joseph Laurent, ce sont les
prétendants byzantins au trône qui les ont pris à leur service comme mercenaires
et les ont établis en garnison dans les villes, d’où il a été impossible de les
chasser. On vient de voir avec quelle inconscience Nicéphore Mélissénos
pratiqua cette politique à Nicée et à Cyzique. On s’explique donc comment, à la
faveur de cette équivoque, des États turcs indépendants se formèrent en Asie
Mineure ; mais avant 1081, les possessions byzantines et turques étaient
si instables et si enchevêtrées que les sources ne permettent pas d’en dresser
les frontières . Il faut y ajouter les
essais d’autonomie politique indépendants de l’Empire et destinés à résister
aux Turcs, comme la tentative de Philarète dans le Taurus .
En 1081 les bandes turques étaient
disséminées dans toute l’Asie Mineure sans beaucoup de liens entre elles. Après
avoir dévasté les campagnes, elles y menaient la vie nomade, tandis que les populations
refluaient vers les villes ou émigraient . On a pu dire que cette
invasion de pasteurs a transformé la terre elle-même et que le plateau
d’Anatolie est redevenu ce qu’il est encore, « un morceau de la steppe
kirghize », tandis que « dans les régions restées cultivées et urbaines
de la côte, en Bithynie, en Mysie, en Ionie », l’occupation turque présentait
déjà un commencement d’organisation . Tel fut le point de
départ de l’État seldjoukide de Nicée, dont le fondateur, Soliman, cousin du
sultan Alp-Arslan, se trouva en 1078 le seul représentant de la dynastie
seldjoukide en Asie Mineure. Il se loua successivement comme mercenaire à
Michel VII contre Nicéphore Botaniatès, puis à Botaniatès lui-même contre
Bryenne et enfin en 1080 à Nicéphore Mélissenos contre Botaniatès avec la
promesse de conserver la moitié des villes et des provinces enlevées à
l’empereur. Ce fut ainsi qu’il s’établit à Nicée d’où il organisa un péage sur
le Bosphore . Cependant son autorité
sur les autres bandes turques était précaire et son établissement n’avait pas
encore un caractère définitif .
Tandis que les hordes turques étaient
dispersées dans la péninsule anatolique, les Arméniens immigrés depuis le xe siècle formaient une masse
compacte à l’ouest de l’Euphrate et dans le Taurus, au sud de la Cappadoce,
débordant en outre dans le nord de la Syrie , avec une colonie
puissante à Antioche. Comme on l’a vu, tout ce territoire, occupé encore par de
faibles garnisons impériales, était sous la domination réelle de Philarète, à
qui Nicéphore Botaniatès avait reconnu la qualité de vassal de l’Empire. En
fait la suzeraineté impériale était illusoire dans ces régions qui
représentaient déjà le cadre de la Petite Arménie. Non seulement les Arméniens
ne rendaient aucun service à Byzance, mais ils étaient obligés de négocier
directement avec les Turcs sans tenir compte des intérêts de l’Empire .
Rapports avec l’Occident. — La situation
de Byzance pendant cette période interdisait tout effort militaire du côté de
l’Italie ; cependant, en dépit du schisme entre les Églises, le
gouvernement impérial n’avait pas perdu l’espoir de conclure une alliance
politique avec la papauté. La correspondance entre Grégoire VII, élu pape en
1073, et Michel VII semble avoir été assez active.
On voit par la réponse du pape que
l’initiative des pourparlers vint du basileus, qui promettait la réunion des
Églises et demandait en échange les secours de l’Occident contre les Turcs,
premier exemple d’un projet d’entente qui devait être souvent renouvelé. La
lettre, portée à Rome par deux moines, reçut une réponse favorable du pape, qui
envoya à Constantinople le patriarche de Venise Dominique (1073) . C’est de cette époque
(1074) que date le projet grandiose de Grégoire VII de conduire lui-même en
Orient une immense armée recrutée dans toute la chrétienté, particulièrement en
France, et destinée à libérer les Églises orientales du joug musulman :
c’était déjà le programme de la croisade, qui devait commencer par combattre
les ennemis les plus proches de l’Église romaine, c’est-à-dire les Normands de
Robert Guiscard. Mais les temps n’étaient pas mûrs. L’émouvant appel du pape
« à tous les chrétiens » ne reçut pas de réponse et il dut renoncer à
son projet .
Tout en négociant avec Grégoire VII,
l’empereur Michel se tournait aussi du côté de Robert Guiscard et, reprenant un
projet d’union matrimoniale qui datait du règne de Romain Diogène, il demandait
au chef normand la main d’une de ses filles pour son frère Constantin . Malgré les honneurs et
les avantages qui lui étaient promis, Guiscard repoussa cette proposition, mais
un fils lui étant né en 1074, Michel VII renouvela sa tentative en demandant la
main de la princesse normande pour cet héritier du trône . Cette fois la
proposition fut agréée ; la princesse, en bas âge, fut transportée à
Constantinople, où elle reçut le nom d’Hélène , mais la chute de
Michel VII en 1078 mit fin à cette politique d’alliances avec l’Occident.
Nicéphore Botaniatès rompit le projet de mariage et enferma la jeune Normande
dans un monastère. Aussitôt Robert Guiscard se déclara le champion de
l’empereur déchu et prépara une expédition contre Byzance, tandis que Grégoire
VII, gagné à ses projets, excommuniait l’usurpateur du trône .
Ainsi de tous les côtés l’Empire ne
subissait que des échecs une lourde tâche était réservée aux Comnènes.
3. La tentative de relèvement des Comnènes. L’Œuvre d’Alexis Ier (1081-1118)
A la veille de sa dissolution, l’Empire fut
sauvé par la dynastie des Comnènes qui lutta pendant un siècle pour le
réorganiser et lui rendre son prestige dans la chrétienté. Sous les trois
princes remarquables qui se succédèrent de père en fils, l’Empire connut de
nouveaux succès militaires et redevint la puissance prépondérante de l’Orient.
Les Comnènes ne s’en trouvèrent pas moins
devant une situation bien plus difficile qu’au temps de la dynastie
macédonienne et leur œuvre de restauration fut incomplète. Représentants de la
noblesse, ils abandonnèrent la lutte traditionnelle du pouvoir central contre
la grande propriété et, pour implanter leur dynastie, favorisèrent la formation
de grands apanages et l’accroissement démesuré de la fortune monastique. Ils
affaiblirent ainsi l’autorité de l’État.
A l’époque macédonienne, les seuls pays de
l’islam se trouvaient au même niveau que l’État byzantin par leurs institutions
et par leur civilisation. Au xiie siècle au contraire, l’Empire doit lutter contre de nouveaux États bien
organisés, dont la puissance militaire et économique cherche à s’étendre aux
dépens de la sienne : Turcs devenus les maîtres des États arabes d’Orient
et fondateurs en territoire hellénique du sultanat de Roum ; Normands
d’Italie, qui grâce à leur armée et à leur marine disputent à Byzance la
maîtrise de la Méditerranée et sont une menace perpétuelle pour Constantinople.
Mais surtout l’Empire byzantin dut faire
face à une immense expansion des peuples d’Occident qui prit la double forme
d’une guerre religieuse, la croisade, et d’une lutte économique menée contre
l’Empire par les républiques italiennes. De plus ce mouvement des croisades eut
pour conséquence une véritable rénovation de l’Occident. De l’émiettement
féodal émergèrent des États bien organisés sous des dynasties nationales. Grâce
à la renaissance de la vie urbaine, au rétablissement de la sécurité, il se
forma de nouvelles puissances maritimes et commerciales avec lesquelles il
fallut compter et, par son magnifique développement intellectuel et artistique,
l’Occident rivalisa bientôt avec Byzance. Sans doute entre ces deux moitiés du
monde chrétien il existait une solidarité vis-à-vis de l’islam, mais le schisme
de 1054 avait divisé d’une manière irrémédiable les Églises d’abord, les
fidèles dans la suite, et devait rendre stériles les efforts des empereurs pour
conclure des alliances avec l’Occident.
Conscients des dangers qui menaçaient
l’Empire, les Comnènes essayèrent, suivant le système traditionnel, de diviser
leurs ennemis, mais leur politique de bascule s’avéra aussi dangereuse
qu’onéreuse. Pour lutter contre les Normands, ils concédèrent aux républiques
italiennes des privilèges économiques qui ruinèrent le commerce et la marine de
Byzance ; contre les empereurs germaniques ils essayèrent de faire des
concessions aux papes sans parvenir à réconcilier l’Église de Constantinople
avec Rome ; ils cherchèrent à exploiter le mouvement de la croisade au
profit de l’Empire, mais, malgré des succès temporaires, un malentendu originel
empêcha toute entente durable entre eux et les croisés ; enfin en attirant
dans leurs armées les auxiliaires francs, ils excitèrent les convoitises des
Occidentaux, qui considérèrent l’Empire comme un territoire de colonisation,
une sorte d’Eldorado où tout chevalier famélique était assuré de faire fortune.
Telles sont les vraies causes qui ont rendu précaires les succès des Comnènes
et préparé la catastrophe qui brisa l’unité de l’Empire en 1204.
L’œuvre d’Alexis Comnène. — On a vu dans
quelle situation misérable Alexis Comnène trouva l’Empire lorsqu’il fut appelé
au trône par l’opinion presque unanime de l’armée : partout l’anarchie et
le désordre ; l’Asie Mineure infestée de Turcs et un État seldjoukide en
train de s’installer à Nicée ; les Normands d’Italie organisant la piraterie
dans l’Adriatique et à la veille d’envahir la péninsule balkanique ; les
Serbes insoumis ; les Bulgares agités par le mouvement bogomile débordant
jusqu’à Constantinople et de nouvelles invasions se préparant au-delà du
Danube.
En 14 ans (1081-1095), au milieu de
difficultés inouïes, Alexis parvint à rétablir l’ordre à l’intérieur et à
arrêter le démembrement de l’Empire. Renonçant à récupérer l’Italie et
momentanément l’Asie Mineure, il lutta victorieusement contre les invasions. En
1095, à la veille de la croisade, il n’y avait plus de menace immédiate contre
l’Empire.
Pour obtenir ces résultats il récompensa le
parti militaire, qui l’avait porté au pouvoir, sans grever le trésor, par des
titres et des honneurs nouveaux, conférés surtout à ses nombreux parents, et il
mit un terme aux révoltes militaires. Aux envahisseurs il opposa des ennemis
par un vaste système d’alliances qui n’était pas toujours sans danger :
alliances avec Venise contre les Normands, avec les Comans contre les
Petchenègues, avec les Francs contre les Turcs.
Mesures à l’intérieur. — Le nouveau
basileus n’était pas un soldat de fortune comme Nicéphore Botaniatès, mais il
appartenait par sa naissance à une famille aristocratique dont un membre,
Isaac, son oncle, avait déjà occupé le trône. Par sa mère, Anna Dalassena, par
sa deuxième femme, Irène Doukas, cousine de Michel VII, il était allié aux plus
puissantes maisons de la noblesse byzantine. Plus encore que sa naissance, les
éminents services qu’il avait rendus à l’Empire, dont il était le meilleur chef
de guerre, l’avaient désigné pour le trône. Élevé par sa mère à laquelle il
montra toujours un grand attachement, il avait reçu l’instruction
encyclopédique de son temps, qui avait fait de lui un humaniste et un
théologien, aimant la controverse . D’après sa fille, il
possédait une éloquence naturelle qui lui donnait une grande autorité. Il
savait surtout parler à ses soldats dont il était l’idole . Rompu aux exercices
physiques et capable de braver les intempéries, il payait de sa personne
pendant les campagnes et entraînait ses troupes par les exploits qu’il
accomplissait comme un simple combattant .
Qu’il fut surtout un politique avisé et un
excellent diplomate, habile à profiter des fautes de ses adversaires, c’est ce
que montre toute son histoire depuis le début de sa carrière jusqu’à la fin de
son règne . Les circonstances
mêmes de son avènement avec la complicité de l’impératrice Marie, les moyens
qu’il employa pour se débarrasser de la rivalité de Nicéphore Mélissenos, qui
voulait partager l’Empire avec lui et dut se contenter du titre de César , en sont la preuve manifeste.
Ce fut aussi avec une véritable dextérité
qu’au lendemain de sa victoire il sut écarter du Palais l’impératrice Marie qui
songeait à l’épouser après son divorce avec Irène Doukas, auquel le poussait sa
mère Anne Dalassène, Marie voulait surtout réserver les droits à la couronne de
son fils Constantin Doukas. La situation fut un moment très tendue. Les
partisans des Doukas, qui avaient aidé Alexis à s’emparer du trône, s’indignaient
de ce qu’Irène n’eût pas été couronnée en même temps que son époux et fût comme
reléguée dans une aile du Palais loin du basileus. L’intransigeance du
patriarche Cosmas, qui refusa de prononcer le divorce d’Alexis et résista aux
menaces d’Anne Dalassène, fit échouer toutes ces combinaisons. Irène fut
couronnée et reprit sa place d’épouse. Marie, après avoir fait reconnaître à
son fils le titre de basileus, se retira au monastère des Manganes .
Avec une véritable souplesse Alexis, qui ne
voulait pas s’aliéner le patriarche, céda aux circonstances afin de consolider
son trône. Ce fut dans le même esprit qu’il s’imposa une pénitence publique
partagée par toute la famille impériale pour expier les dévastations commises
par ses troupes sur des biens d’églises à son entrée dans Constantinople et qu’en 1083, une
fille lui étant née, il la fiança à Constantin Doukas : en l’absence d’un
fils ces deux enfants devenaient les héritiers du trône . Par contre, après la
naissance de Jean Comnène (1088) et son association au trône (1092), Alexis
priva Constantin Doukas des insignes impériaux et força l’impératrice Marie à
revêtir la robe noire des moniales . Les Comnènes
l’emportaient finalement sur les Doukas et Anne Porphyrogénète, mariée à Nicéphore
Bryenne créé César, perdait tout espoir de succession à la couronne .
Il n’en reste pas moins que la dynastie
déchue ne se résigna jamais complètement à sa défaite. Au cours de son long
règne Alexis Comnène faillit être victime de plusieurs complots. Le plus dangereux,
celui de Nicéphore Diogène, frère utérin de Michel VII, mais écarté du trône
comme né avant l’avènement de son père, avait pour complices des personnages
considérables comme Kekaumenos Katakalon et l’Arménien Michel Taronitès,
beau-frère du basileus : l’impératrice Marie était au courant du complot,
qui aurait été révélé à Alexis par l’infortuné Constantin Doukas (mai-juin
1094). A travers les réticences et les contradictions du récit d’Anne Comnène,
on devine que si l’empereur amnistia les conjurés, ce fut à cause des craintes
que lui causèrent leur nombre et leur qualité et il est peu probable qu’il
n’ait pas été au courant, s’il n’en a même pas donné l’ordre, du supplice
infligé par ses familiers à Nicéphore Diogène et à Katakalon .
La création d’une nouvelle hiérarchie
comportant des titres splendides, sébastocrator, panhypersébaste, etc., mais
purement honorifiques et distribués surtout aux membres de la famille
impériale, fut l’une des principales mesures d’Alexis à son avènement . Par contre le
basileus, jaloux de son autorité et décidé à gouverner l’Empire par lui-même,
s’entourait de conseillers d’un rang des plus modestes, parmi lesquels
plusieurs Francs, qui montrent ainsi le commencement de l’importance que les
Occidentaux devaient prendre dans l’Empire . Et c’est d’ailleurs ce
qui explique les rapports tendus qui existèrent pendant tout son règne entre
l’empereur et le Sénat, mécontent d’être dépossédé de son rôle de conseil
suprême de l’Empire ; d’où la participation de plusieurs sénateurs aux
complots fomentés contre Alexis . Lorsque, quelques mois
après son avènement, encore mal assis sur le trône, Alexis dut quitter
Constantinople pour repousser l’invasion normande, ce ne fut ni au Sénat, ni au
Préfet de la Ville, mais à sa mère Anna Dalasséna qu’il confia le gouvernement
de l’Empire en lui donnant une autorité absolue sur tous les services de
l’État .
Ces premiers actes de Comnène montrent par
quels moyens il a pu réorganiser l’administration byzantine. Lorsqu’il prit le
pouvoir, la situation intérieure, a-t-on pu dire, était au moins aussi mauvaise
qu’à l’avènement d’Héraclius . Le pouvoir central
n’était plus obéi, la famine était menaçante, la monnaie impériale, qui avait
fait prime jusque-là dans le monde entier, perdait sa valeur, le système économique
et social qui avait fait la grandeur et la prospérité de l’État byzantin était
ruiné. Alexis parvint à restaurer l’autorité de l’État, mais sans pouvoir
revenir à l’organisation antérieure et au bel équilibre social et politique
d’autrefois. Ce fut bien souvent par des expédients dommageables à l’État par
quelque côté, qu’il se tira d’une situation périlleuse .
L’œuvre que la situation extérieure
imposait d’abord était celle du recrutement et de la réforme de l’armée. Pris
de court par les circonstances, Alexis ne pouvait songer à restaurer l’ancienne
organisation des thèmes et était obligé d’avoir recours à des mercenaires de
toute race, en marquant sa préférence pour les Occidentaux, Français, Normands
d’Italie, Anglo-Saxons. Mais la difficulté était d’assurer à ces troupes une
solde régulière, seul garant de leur fidélité. Or, le trésor étant vide, Alexis
employa des pratiques nuisibles à l’État confiscation des trésors d’églises, au
grand mécontentement du clergé, pour équiper une armée contre les Normands en
1081 ;
nombreuses confiscations des biens des nobles convaincus de complot ;
concessions en bénéfice (charisticares) à des particuliers de biens de couvents
moyennant le service militaire de leurs parèques ; affermage des
impôts ; altération des monnaies . Toutes ces pratiques
expliquent l’impopularité d’Alexis : des provinciaux préféraient la domination
barbare à celle de Byzance et en 1095 on vit des villes de Thrace ouvrir leurs
portes aux Comans .
Enfin les questions religieuses,
disciplinaires et même dogmatiques, tinrent une très grande place dans la
politique intérieure d’Alexis, qui avait une haute idée de son rôle
apostolique. Il sera question ailleurs, dans l’étude des institutions ecclésiastiques,
de la difficulté avec laquelle il rétablit l’ordre dans les monastères de
l’Athos, ainsi que de ses nombreuses fondations monastiques et des statuts
qu’il leur accorda. Il intervint en outre dans les querelles dogmatiques et
entreprit de défendre l’orthodoxie contre les doctrines hérétiques de son
temps, issues, les unes du mouvement bogomile qui de Bulgarie étaient propagées
jusqu’à Constantinople, les autres de l’enseignement néoplatonicien de Psellos,
continué par son disciple Jean l’Italien, après lui « consul des philosophes », dignité qui plaçait sous sa
direction l’Université impériale.
Les épisodes les plus importants de ces
luttes furent le procès intenté à Jean l’Italien, d’abord devant le synode,
puis devant un tribunal mixte nommé par le basileus (1082) ; l’affaire de
Léon, évêque de Chalcédoine, qui, pour protester contre la réquisition des
trésors d’églises, dont les pièces étaient la plupart décorées de figures
sacrées, soutint que l’adoration des icônes devait s’étendre à la matière même
dont elles étaient faites, ce qui équivalait à accuser l’empereur de sacrilège
(il fut condamné à la déposition et à l’exil par un concile tenu aux Blachernes
en 1086) ; la condamnation
de deux disciples de Jean l’Italien, le moine Nil (qu’Alexis avait essayé de convertir
lui-même), et Eustratios, évêque de Nicée ; enfin les
poursuites contre les Bogomiles, dont le chef, le bulgare Basile, fut brûlé
vif, après être tombé dans le piège que lui avait tendu Alexis en lui faisant
exposer ses doctrines et en feignant de les approuver . Toutes ces mesures de
rigueur devaient être d’ailleurs inefficaces et toute l’époque des Comnènes fut
troublée par ce regain de controverses théologiques.
La défense de l’Empire. — Au milieu
d’immenses difficultés Alexis Comnène réussit à sauver Constantinople et, non
sans faire des sacrifices, à défendre les frontières menacées par les Normands,
les Serbes, les Petchenègues et les Turcs. Il a dû faire face à l’ennemi sur
trois fronts, parfois simultanément, avec des effectifs souvent insuffisants et
une armée de mercenaires composée de troupes fournies par les émirs turcs et
les joupans serbes, en théorie vassaux de l’Empire, de contingents levés chez
les Petchenègues et les Comans et d’un grand nombre de Francs.
Ainsi qu’on l’a vu, Robert Guiscard, qui
prétendait venger Michel VII, se préparait à envahir l’Empire au moment même où
Alexis s’emparait du trône (1er avril). Il avait déjà envoyé son
fils Bohémond occuper la baie d’Avlona et, ses préparatifs terminés en mai
1081, il s’emparait de l’île de Corfou et attaquait Durazzo . Manquant de troupes et
menacé en même temps par les progrès de Soliman, établi à Nicée et à Cyzique,
Comnène prit le parti de traiter avec le Turc et de le prendre au service de
l’Empire . En même temps il cherchait
à faire alliance avec tous les ennemis des Normands, envoyait une ambassade
avec des présents à l’empereur germanique Henri IV, en train d’assiéger
Grégoire VII à Rome et demandait à Venise
d’envoyer sa flotte au secours de Durazzo . Les Vénitiens armèrent
en effet une escadre importante qui détruisit la flotte normande et reçurent
d’Alexis en récompense des privilèges commerciaux dans l’Empire (juillet
1091) .
Cependant la lutte devait durer près de 4
ans. L’armée improvisée par Comnène fut battue et dispersée devant Durazzo (8
octobre 1081) et cette place tomba au
pouvoir de Guiscard le 21 février suivant . La route de Constantinople,
l’ancienne Via Egnatia, était libre et les Normands s’y engagèrent, mais arrivé
à Castoria, Robert Guiscard reçut la nouvelle de la révolte de ses vassaux et
une lettre de Grégoire VII, serré de près à Rome par Henri IV et invoquant le secours
des Normands . Retournant en Italie,
il confia le commandement de l’armée à Bohémond qui, interrompant la marche sur
Constantinople, tourna vers le sud et assiégea Ioannina (Janina) en infligeant
deux défaites successives à la nouvelle armée formée par Alexis (mai
1082) . En quelques mois
Bohémond occupa la région des lacs et la Macédoine occidentale, puis passa en
Thessalie où il assiégea Larissa. Au printemps de 1083, Alexis marcha au
secours de la place et par un stratagème grossier fit entraîner l’armée
normande loin de son camp qu’il pilla et détruisit de fond en comble . Privé de ressources, Bohémond
battit en retraite et revint à Castoria. Là les intrigues du basileus, qui
s’aboucha avec des chefs normands mécontents de ne plus toucher leur solde, le
déterminèrent à aller chercher de l’argent en Italie. Après son départ Alexis
reprit facilement Castoria (octobre 1083) .
La partie était perdue pour les Normands.
Dans une seconde campagne (automne et hiver de 1084) Robert Guiscard put
infliger un grand désastre à une flotte vénitienne, reprendre Corfou et aborder
dans le golfe d’Arta, mais une épidémie décima son armée et Bohémond dut
regagner l’Italie. Dans l’été de 1085 Guiscard envoya son autre fils, Roger,
occuper Céphalonie. Il l’y rejoignit, mais ce fut pour y mourir le 17 juillet
(1085) . Suivant ses volontés
Roger lui succéda comme duc de Pouille et de Calabre, mais la guerre civile qui
éclata entre lui et Bohémond arrêta toute nouvelle entreprise contre
l’Empire , qui recouvra Durazzo .
La question turque. — Le traité
conclu par Alexis Comnène avec Soliman lui avait procuré des soldats et permis
de poursuivre sa lutte contre les Normands sans avoir à craindre une attaque de
Constantinople. Cependant le vasselage de Soliman à l’égard de l’Empire était
purement théorique et il ne tenait pas plus compte du pouvoir d’Alexis que de
celui de son cousin le sultan seldjoukide Malek-Schah . Agissant en souverain
indépendant, il avait pris le titre de sultan et cherchait à agrandir son État.
Inquiet du développement de la puissance territoriale de Philarète, il occupa
Antioche, qui lui fut livrée par une partie des habitants (décembre 1084), sans
qu’Alexis, impuissant, ait pu songer à intervenir .
Après la prise d’Antioche, Philarète, bien
qu’il se fût converti probablement à l’islam, perdit tous ses autres domaines,
qui lui furent enlevés par ses nouveaux coreligionnaires ; il était
d’ailleurs détesté de ses Sujets arméniens et syriens .
D’autre part l’acquisition d’Antioche et la
victoire qu’il remporta sur l’émir d’Alep, qui lui réclamait le tribut payé par
Philarète, avaient accru à tel point la puissance de Soliman, que les autres
émirs en furent effrayés. Celui de Damas, Toutouch, l’attaqua et Soliman périt
dans la bataille qui se livra près d’Alep (juillet 1085) . Sa mort faillit amener
la dislocation de son État : tous les émirs qu’il avait établis en Asie
Mineure cherchèrent à se rendre indépendants, tandis que Malek-Schah envoyait
une armée en Syrie pour y rétablir son autorité et venait lui-même procéder à
un nouveau partage des territoires entre ses émirs .
Alexis Comnène avait une belle occasion de
profiter des divisions de ses ennemis pour rétablir l’autorité impériale en
Anatolie, mais toutes ses forces concentrées en Europe faisaient face à
l’invasion des Petchenègues. Il eut recours du moins à sa diplomatie
habituelle. Malek-Schah ayant sollicité son alliance, il corrompit son
ambassadeur, le détermina à recevoir le baptême et se fit livrer par lui
l’important port de Sinope . Mais à ce moment
toutes les troupes dont il disposait étaient occupées contre les barbares du
Danube.
Les invasions des Petchenègues. — Les
Petchenègues avaient résisté à tous les efforts du gouvernement impérial pour
les convertir au christianisme et les civiliser. Renforcés sans cesse de
nouvelles hordes venues des steppes russes, ils avaient profité des guerres
civiles pour s’installer dans l’ancienne Bulgarie entre le Danube et les
Balkans , où ils avaient les
meilleurs rapports avec tous les mécontents révoltés contre l’Empire, notamment
avec les chefs de la colonie manichéenne de Philippopoli, dont les troupes
avaient déserté pendant l’expédition normande et avaient subi des représailles.
Ce fut l’un d’eux, Traulos, qui, après
avoir épousé la fille d’un de leurs chefs, les excita à la guerre contre
l’Empire . Grossis de hordes
d’outre-Danube et après avoir fait alliance avec le peuple nomade des Comans,
leurs frères de race , les Petchenègues
envahirent la Thrace en 1086, écrasèrent l’armée du domestique des scholes
Pakourianos, mais durent battre en retraite devant une nouvelle armée levée par
Tatikios, qui leur barra les routes d’Andrinople et de Philippopoli .
Ils revinrent deux ans de suite. En 1087
ils purent arriver jusqu’à une journée de Rodosto sur la Propontide, mais
furent mis en déroute par une armée impériale et obligés de repasser les
Balkans . A l’automne suivant
l’offensive vint de Comnène, qui organisa contre eux une expédition à la fois
terrestre (par les Balkans) et maritime (par une flotte remontant le Danube).
Les Petchenègues demandèrent la paix, qui leur fut refusée ; l’armée
impériale fut complètement détruite à Dristra sur le Danube ; Alexis en
grand danger s’enfuit jusqu’à Berrhoé . Constantinople menacée
ne dut son salut qu’à la discorde qui éclata entre les Petchenègues et les
Comans qui, arrivés après la bataille, réclamaient une part du butin . Les deux peuples en
vinrent aux mains et les Petchenègues eurent le dessous, ce qui permit au
basileus de former une nouvelle armée : ce fut alors que le comte de
Flandre Robert, revenant de Jérusalem, promit de lui envoyer 500
chevaliers . Les Petchenègues
revenaient quelques mois après, mais les Comans les suivaient, menaçants ;
d’autre part Alexis n’osait accepter leur proposition d’alliance. Il accueillit
donc les demandes de paix des Petchenègues et fit interdire le passage des Balkans
à leurs adversaires ; mais les Comans
étaient à peine partis que les Petchenègues violaient le traité et attaquaient
Philippopoli dépourvu de troupes, Alexis fut réduit à leur faire une guerre
d’embuscade et fut trop heureux de signer avec eux une nouvelle trêve
Turcs et Petchenègues. — Constantinople
était alors menacée de la double attaque des peuples du Danube et des émirs
turcs, en particulier de l’émir de Smyrne, Tzachas, et du successeur de Soliman
à Nicée, Abou’l Qasim qui avait pris le titre de sultan et ravageait la
Bithynie . Plus dangereux encore
était Tzachas : fait prisonnier et entré au service de Nicéphore
Botaniatès qui le créa protonobilissime, il s’enfuit à l’avènement d’Alexis et
se fit chef de pirates avec le dessein arrêté de prendre Constantinople par
mer. Un Smyrniote lui construisit une flotte légère, recruta des équipages, et
il s’empara en peu de temps de Phocée, Clazomène, Chio, Samos et Rhodes. Une
flotte impériale envoyée contre lui subit un échec complet, mais une seconde
expédition dirigée par Constantin Dalassène parvint à lui reprendre l’île de
Chio .
Tzachas conçut alors un plan d’une grande
hardiesse. Comprenant qu’une attaque de Constantinople par mer ne pouvait
réussir que si la ville était bloquée en même temps par terre, il poussa les
Petchenègues à entrer de nouveau en campagne, tandis qu’Aboul’l Qasim attaquait
Nicomédie . Alexis rappela de
Durazzo son beau-frère Constantin Doukas pour le mettre à la tête d’une expédition
par terre et par mer contre Tzachas retranché à Smyrne , chargea les 500 chevaliers
envoyés par le comte de Flandre de défendre Nicomédie contre le sultan de Nicée et marcha lui-même
contre les Petchenègues, mais ne put défendre les places qui protégeaient les
abords de la ville impériale. Battu à Rodosto, il retrancha son armée à
Tzurulon (Tchorlou) qu’il défendit efficacement contre l’ennemi .
Alexis n’en était pas moins coupé du reste
de l’Empire, mais les Petchenègues ayant établi leurs quartiers d’hiver dans la
région de la Maritza, il concentra ses forces à Ænos où il trouva une armée
levée par le César Nicéphore Mélissène en Macédoine et où il amena lui-même les
chevaliers flamands. Ayant appris que Tzachas équipait une nouvelle flotte et
engageait les Petchenègues à occuper la péninsule de Gallipoli, il voulait
prévenir la jonction des alliés et il avait fait appel aux Comans, qui
arrivèrent en grand nombre, mais il eut soin de mettre la Maritza entre eux et
son armée . Le 29 avril 1091, au
pied de la colline du Lebounion , les Petchenègues
subirent une déroute complète qui se termina par un massacre effroyable. On a
pu dire que tout un peuple périt dans cette bataille, car dans la suite il
n’est plus question des Petchenègues comme nation, mais ceux qui survécurent
furent enrôlés dans l’armée impériale .
L’écrasement des Petchenègues était en même
temps un gros échec pour Tzachas, dont le plan si bien élaboré devenait
inexécutable. Il n’en persista pas moins dans ses prétentions et, d’après Anne
Comnène, il se serait arrogé le titre de basileus . Ce fut certainement à
cette époque que son principal allié, Aboul’l Qasim, sultan de Nicée, prépara
une agression contre Constantinople, mais, battu sur terre et sur mer par
Tatikios et Boutoumitès, accepta le traité d’alliance que lui proposait Alexis . Le basileus qui
voulait construire la ville forte de Civitot aux abords de Nicomédie pour y
poster ses mercenaires anglo-saxons, invita Abou’l Qasim à venir à
Constantinople et le retint au milieu des fêtes de toute sorte jusqu’à
l’achèvement des travaux de la forteresse . Lorsque Nicée fut menacée
par l’armée du sultan seldjoukide Malek-Schah, Alexis secourut Abou’l Qasim
avec le secret espoir de reprendre cette ville : Tatikios, chef de
l’expédition, fit bien lever le siège de Nicée aux assaillants, mais n’osa
pénétrer dans la ville à cause de la faiblesse de ses effectifs . Malek-Schah envoya
alors en Asie Mineure une nouvelle armée ; son chef, Pouzan, gouverneur
d’Édesse, était porteur d’une lettre par laquelle le sultan offrait à Alexis de
le débarrasser d’Abou’l Qasim, de lui restituer Nicée et Antioche, s’il voulait
accorder la main d’une de ses filles à son fils aîné. Abou’l Qasim, serré de
près, prit le parti d’aller trouver le sultan seldjoukide avec des présents,
mais il périt étranglé et lorsque la réponse d’Alexis à Malek-Schah arriva à
destination, celui-ci venait de mourir : Nicée échut d’abord au frère
d’Aboul’l Qasim, Poulchas, puis le nouveau sultan de Perse y rétablit le fils
de Soliman, Qilidj-Arslan .
Tzachas lui-même, qui préparait à Smyrne
une nouvelle flotte, fut prévenu par une offensive dirigée par Jean Doukas et
Constantin Dalassène, grand-drongaire de la flotte. Ils attaquèrent avec succès
Mytilène et forcèrent Tzachas à s’enfuir à Smyrne (1092) . L’année suivante ce fut
Tzachas qui entra en campagne et alla assiéger Abydos, dont la possession lui
eut permis d’intercepter la route de Constantinople. Mais Alexis Comnène avait
fait alliance avec Qilidj Arslan qui joignit ses forces à celles de Constantin
Dalassène : Tzachas, se sentant trop faible, alla trouver le sultan, qui
l’égorgea après l’avoir enivré (printemps de 1093).
Constantinople était dégagée de tout danger immédiat.
L’Empire à la veille de la croisade. — En 1095, après
un règne de 14 ans, Alexis avait mis fin aux guerres civiles, repoussé trois
invasions dirigées contre Constantinople et recouvré quelques positions
importantes. L’Empire était loin d’avoir retrouvé la prospérité et la puissance
d’autrefois. Alexis Comnène avait du moins assuré son existence.
En Asie la succession du grand sultan
Malek-Schah avait provoqué une guerre civile et entraîné la révolte de tous ses
vassaux . Toutes les forces
musulmanes avaient reflué vers l’Orient (1092-1095). Alexis en avait profité
pour reprendre Cyzique et Apollonia et il était en bons
rapports avec le nouveau sultan de Nicée, Qilidj-Arslan, qui venait de l’aider
à ruiner la puissance de Tzachas. « Le calme régnait dans les provinces
maritimes », dit Anne Comnène .
En Europe le peuple des Petchenègues était
anéanti, mais les frontières étaient menacées par les Serbes et les Comans. En
Serbie le fils de Michel Bogislav, Constantin Bodin, qui résidait à Scutari
dans la Dioclée, avait soumis les joupans de Rascie et déplacé ainsi vers l’est
le centre de l’État serbe . Hostile à l’Empire,
dont il était le vassal, il trahit Alexis Comnène à la bataille livrée aux
Normands devant Durazzo, le 18 octobre 1081, en se retirant sans
combattre ; puis il profita
des embarras du basileus pour pousser ses entreprises sur la côte dalmate et
s’implanter sur le plateau de Rascie . En 3095 le duc de
Durazzo, Jean Comnène, neveu d’Alexis, eut à combattre l’un des joupans de
Rascie, Bolkan , qui envahit la
Macédoine et obligea Alexis Comnène à intervenir lui-même deux fois, en 1093 et
1094 ; mais le chef serbe avait dû demander la paix (juin 1094) et la guerre civile qui
éclata entre Bodin et ses parents mit fin aux agressions serbes contre
l’Empire .
Au moment où il traitait avec Bolkan,
Alexis avait reçu la nouvelle d’une invasion de ses anciens alliés les Comans.
Ils avaient à leur tête un imposteur qui se faisait passer pour un fils de
Romain Diogène. Après être parvenus à franchir les Balkans, ils marchèrent sur
Andrinople qui fut défendue par le fils de Nicéphore Bryenne. Alexis, qui avait
concentré une armée à Anchiale, se disposait à intervenir quand l’imposteur fut
fait prisonnier et envoyé à Constantinople. Privés de leur chef, les Comans se
dispersèrent pour piller et repassèrent le Danube en désordre .
Ainsi en 1095 il n’y avait plus de menace
immédiate contre l’Empire. La situation intérieure était améliorée : des
tentatives de chefs provinciaux dans les îles de Crète et de Chypre pour se
rendre indépendants avaient été réprimées ; Chypre, base de toute
opération contre la Syrie et l’Égypte, avait été pourvue d’une flotte . Seul Théodore Gavras,
stratège du thème de Chaldia, avait fait de Trébizonde le siège d’une
principauté autonome Alexis Comnène avait
fait exécuter des travaux de défense à la frontière de Serbie et en Asie
Mineure, pour protéger l’étroite bande de territoire que l’Empire possédait
encore entre la mer Noire et la Propontide . Les troupes étaient
dispersées le long des frontières et ne pouvaient être rappelées sans
danger . La faiblesse de ces
effectifs rendait la défense difficile et c’est ce qui explique les efforts
continuels faits par Alexis pour se procurer des mercenaires en Occident.
Rapports diplomatiques avec l’Occident. — On a fait
bonne justice de l’assertion d’après laquelle le mouvement de la croisade
serait dû aux sollicitations d’Alexis Comnène, qui aurait montré ensuite la
plus noire ingratitude envers ses défenseurs . La vérité est très
différente. Au début de son règne, Alexis, ainsi qu’on l’a vu, était en très
mauvais termes avec le pape Grégoire VII, qui l’avait excommunié et favorisait
les entreprises de Robert Guiscard contre l’Empire. Par représailles le
basileus avait interdit l’usage des azymes dans les églises latines de
Constantinople suivant l’ordonnance de Kéroularios . Or, c’est là un
premier fait, ce fut de Rome que vint l’offre d’une réconciliation. Otton de
Lagery, élu pape sous le nom d’Urbain II, le 12 mars 1088, manifesta dès son
avènement une très grande largeur de vues en regardant une réconciliation avec
l’Église byzantine comme le seul moyen de délivrer les Églises d’Orient du joug
des Turcs. Dès son élection il envoya une ambassade au basileus pour lui
demander de rapporter la mesure contre l’usage des azymes et de faire inscrire
son nom sur les diptyques. Par contre il relevait Comnène de l’excommunication
jetée sur lui par Grégoire VII .
L’empereur saisit avec empressement cette
occasion de renouer avec Rome et invita Urbain II à venir lui-même tenir un
concile à Constantinople pour régler ces questions . Il régnait alors un
véritable désir de conciliation entre les fidèles des deux Églises, dont
plusieurs, comme le clerc d’Amalfi Laycus et l’archevêque d’Ochrida Théophylacte,
pensaient que les querelles sur les rites et les usages étaient vaines et même
ridicules, alors que ce qui importait le plus était la communion dans la même
foi .
Alexis obtint du synode patriarcal que le nom du pape serait rétabli dans les
diptyques à condition qu’il envoyât sa synodique et vînt tenir un concile à
Constantinople, et dans sa réponse à Urbain II le basileus affirmait qu’il n’y
avait pas de schisme entre les deux Églises . La négociation faillit
dévier : ces écrits ayant été transmis à Basile, archevêque de Reggio,
brouillé avec Urbain II et chassé de son diocèse, furent envoyés par lui à
l’antipape Clément III, qui écrivit au patriarche de Constantinople qu’il était
prêt à signer l’union, mais Alexis resta fidèle à Urbain II. Ce n’en furent pas
moins les intrigues de Clément III qui empêchèrent le pape légitime de se
rendre à Constantinople .
Dans la pensée d’Urbain II l’union
religieuse entre Rome et Constantinople devait permettre une offensive des
forces de toute la chrétienté contre l’islam : l’idée qui revient sans
cesse dans ses appels à la croisade est celle de la délivrance des Églises
d’Orient, opprimées par les infidèles , et c’est en ce sens
que les expéditions organisées par l’Ordre de Cluny contre les Maures d’Espagne
ont servi de modèle à la croisade. Le point de vue d’Alexis était beaucoup plus
terre à terre. En cherchant à se rapprocher du Saint-Siège, il songeait surtout
à obtenir des facilités pour lever des troupes parmi ces chevaliers d’Occident
dont il appréciait l’esprit belliqueux et le courage. Des demandes de ce genre
furent sans doute faites au pape dans l’ambassade qu’il lui envoya en 1091 au
sujet du futur concile , mais il y en avait eu
d’autres précédemment, car au printemps de cette même année il faisait traîner
en longueur les négociations avec les Petchenègues « parce qu’il attendait
une armée de mercenaires
(μισθοφορικόν) de
Rome » .
Il semble surtout que l’appel d’Alexis ait
été encore plus pressant au concile réformateur tenu par Urbain II à Plaisance
du 1er au 7 mars 1095. Le seul témoignage précis est celui du
chroniqueur Bernold de Constance , qui montre l’ambassade
d’Alexis implorant les secours de tous les chrétiens pour l’aider à défendre
l’Église et repousser les païens établis presque en face des murs de
Constantinople, puis le pape exhortant les fidèles à s’engager par serment à
répondre à cet appel . Malgré les objections
de Chalandon , on ne peut récuser ce
témoignage très net : sans doute dans tous ces pourparlers il n’est pas
question de la délivrance du Saint-Sépulcre ; ce n’est pas encore la
croisade, mais c’est déjà une guerre sainte à laquelle tous les chrétiens de
bonne volonté participeront. En fait, le soulèvement des peuples que suscita la
prédication de la croisade était aussi imprévisible pour Alexis Comnène que
pour Urbain II lui-même.
La croisade. — La croisade fut en
effet un mouvement sans précédent. Sans doute l’idée de la guerre sainte contre
les infidèles existait depuis longtemps aussi bien à Byzance qu’en Occident , mais les expéditions
entreprises ou projetées à ce titre avaient des buts précis et des objectifs
limités. Ce qui fut nouveau et véritablement inouï, ce fut le soulèvement à la
même heure de tous les peuples de l’Europe occidentale, de toutes les
conditions sociales, de toutes les races, pèlerinage grandiose du peuple
chrétien tout entier succédant aux innombrables pèlerinages particuliers qui
cheminaient depuis des siècles sur les routes de l’Europe et de l’Asie . Sans doute parmi les
croisés se trouvaient des calculateurs et des chercheurs d’aventures, mais
seuls une foi ardente, un désintéressement complet purent provoquer un pareil
exode des masses populaires, semblable à une révolution universelle, à une
Apocalypse vécue .
Un pareil mouvement était incompréhensible
à des politiques avisés comme Alexis Comnène et les hommes d’État qui
l’entouraient. Connaissant mal l’Occident, ils étaient absolument fermés aux
grands élans idéalistes tels que la réforme ecclésiastique et la croisade,
qu’ils n’envisageaient qu’au point de vue étroit des intérêts de l’Empire. Ils
ne virent dans les chefs croisés que des mercenaires capables de recommencer
l’épopée byzantine. Ils s’attachèrent à en faire des vassaux et à exploiter
leurs victoires au mieux des intérêts de la Romania. De là entre Byzance et les
croisés un malentendu irréductible qui engendra des haines et des guerres
inexpiables, au grand dommage de la chrétienté.
Les rapports d’Alexis avec les croisés. — Les premiers
croisés qui traversèrent l’Empire s’étaient embarqués par bandes séparées dans
les ports de l’Italie méridionale. Dés qu’il en fut averti, Alexis prit toutes
les mesures nécessaires pour assurer leur ravitaillement et leur interdire tout
pillage . Constantinople eut
alors à supporter le passage des bandes populaires, innombrable armée sans discipline,
composée en partie de gens sans aveu et de pillards ; elles arrivèrent en
deux vagues, précédées d’un immense nuage de sauterelles, la bande de
Gautier-sans-Avoir le 20 juillet 1096, celle de Pierre l’Hermite le 1er août .
Afin de les empêcher de piller Constantinople, l’empereur leur fit traverser le
Bosphore et les cantonna à Civitot, d’où, malgré les avis qui leur avaient été
donnés, ils voulurent attaquer les Turcs de Nicée et ils furent en grande
partie massacrés . Leurs débris furent
ramenés au-delà du Bosphore .
Cependant à cette croisade démagogique
succédèrent les armées régulières commandées par des princes souverains, qui
atteignirent Constantinople entre la fin de l’année 1096 et le mois de mai
1097 .
Alexis envoya au-devant de chaque bande des officiers chargés de l’accueillir
et de lui promettre des vivres pendant sa traversée de l’Empire, mais en outre
les croisés devaient être suivis à distance de corps de troupes, surtout de
Petchenègues, chargés de surveiller leur marche et de réprimer au besoin leurs méfaits ;
il en résulta des conflits et des luttes parfois sanglantes qui contribuèrent à
envenimer les rapports entre les croisés et les indigènes . D’autre part, la
concentration de toutes les armées à Constantinople devait permettre à Alexis
d’agir sur tous les chefs de la croisade au mieux de ses intérêts. Il adopta
donc vis-à-vis des grands barons deux règles de conduite : les obliger à
leur passage à lui prêter le serment féodal suivant les formes usitées en
Occident ; transporter les armées en Asie au fur et à mesure de leur
arrivée afin d’éviter leur jonction à Constantinople, ce qui n’eût pas été sans
danger. Le serment féodal, sous la forme de l’hommage, revenait à faire des
princes croisés les vassaux de l’Empire pour toutes les terres qu’ils conquerraient :
ils devenaient ainsi les hommes du basileus, d’où la répugnance de plusieurs
d’entre eux à prêter un serment incompatible avec leur vœu de croisade .
Le premier baron qui arriva à
Constantinople, Hugue de France, accepta sans résistance cette obligation
(novembre 1096) , mais il n’en fut pas
de même de Godefroy de Bouillon qui commandait l’une des plus fortes armées de
la croisade et qui refusa d’avoir tout rapport avec le basileus. Alexis coupa
d’abord les vivres à son armée, puis cette mesure ne suffisant pas, il employa
la force, et ce fut seulement après avoir subi l’assaut de l’armée impériale
qu’après 2 mois de résistance Godefroy prêta le serment et se laissa
transporter en Asie avec son armée . Bien au contraire,
l’ancien adversaire d’Alexis, Bohémond, chef des Normands d’Italie, dont la
présence pouvait à bon droit inquiéter le basileus, montra le plus grand
empressement à devenir son homme-lige et reçut en récompense de magnifiques
cadeaux, mais, désireux de prendre pied dans l’Empire et de se tailler une
principauté en Asie, il demanda le titre de domestique des scholes d’Orient,
qui eût fait de lui le chef de l’armée impériale. Sans lui opposer un refus
formel, Alexis lui fit une réponse dilatoire .
La plupart des chefs croisés prêtèrent le
serment, sauf Tancrède, qui passa en Asie sans venir à Constantinople , et Raimond de
Saint-Gilles, comte de Toulouse, qui se montra irréductible en protestant que
ce n’était pas pour un seigneur temporel qu’il avait pris la croix et qui, sur
les objurgations des autres princes, jura seulement qu’il n’attenterait en rien
à la personne d’Alexis .
L’empereur ayant ainsi obtenu de presque
tous les chefs croisés les garanties qu’il désirait, il restait à en assurer
l’exécution, et l’occasion s’en présenta bientôt. Lorsque après sept semaines
de siège les croisés se disposaient à donner l’assaut à Nicée (19 juin), Alexis
traita séparément avec la garnison turque, qui capitula, et fit occuper la
ville par ses troupes . Il y avait seize ans
que la ville était au pouvoir des Turcs et tous les efforts d’Alexis pour la
recouvrer avaient été infructueux sa délivrance était donc une grande victoire
pour l’Empire et, bien que les chroniqueurs occidentaux expriment leur
indignation de la conduite d’Alexis, les chefs croisés, en lui abandonnant la
place, n’avaient fait que tenir leur promesse. Loin de se brouiller avec
l’empereur, ils se rendirent avec empressement à l’entrevue qu’il leur proposa
à Pelekanon, y renouvelèrent leurs serments et en partirent comblés de
magnifiques présents .
D’autre part, la prise de Nicée, suivie de
la victoire des croisés sur l’armée de Qilidj Arslan à Dorylée (1er juillet 1097), eut pour conséquence la dislocation du premier État seldjoukide
et le renversement de la situation en Asie Mineure. Pendant que les croisés
pénétraient sans résistance au cœur même des possessions continentales de
l’ancien sultan de Nicée, Alexis Comnène envoyait une expédition par terre et
par mer, sous les ordres de son beau-frère Jean Doukas, contre les émirs
maritimes. Successivement Smyrne, Éphèse, Sardes, tout l’ancien thème
Thracésien et une partie du thème Cibyrrhéote jusqu’à Attalie furent recouvrés,
tandis que le basileus lui-même réoccupait toute la Bithynie . L’Empire retrouvait
ainsi la base de sa puissance.
Pendant le siège de Nicée, Alexis avait
conclu avec les chefs croisés un traité par lequel il s’engageait à assurer la
sécurité de tous les croisés pendant leur passage dans l’Empire, à prendre
lui-même la croix, et à se mettre à leur tête pour aller délivrer
Jérusalem . En attendant qu’il pût
tenir sa promesse, il avait adjoint à l’armée des croisés un corps de troupes,
commandé par l’un de ses meilleurs généraux, Tatikios, qui prit part à toutes
les opérations des croisés , Mais lorsqu’en juin
1098 Alexis, ayant achevé la conquête de l’État seldjoukide, quitta
Constantinople avec une forte armée pour rejoindre la croisade , la situation avait
entièrement changé et il ne restait plus grand-chose des accords conclus avec
le basileus.
Ce furent d’abord les entreprises
particulières de Baudouin et de Tancrède, qui se séparèrent de l’armée
(septembre 1097) et délivrèrent la Cilicie, faisant fuir devant eux les
garnisons seldjoukides , puis l’expédition de
Baudouin en Haute Mésopotamie, où il fit alliance avec des chefs arméniens,
dont plusieurs étaient d’anciens vassaux de Philarète, enfin son adoption par
le prince arménien d’Édesse, suivie de la prise de possession de la ville et de
son territoire, sans égard pour les traités signés avec Alexis, à qui
d’ailleurs Baudouin n’avait pas prêté serment .
Graves surtout furent les événements
d’Antioche, dont les croisés avaient commencé le siège le 21 octobre 1097 et
dont, à part la citadelle, ils s’étaient emparés le 3 juin 1098 . Bohémond, qui prit une
part prépondérante aux opérations du siège, entendait rester maître de la place
et, ne pouvant compter sur l’appui d’Alexis, il aurait provoqué le départ de
Tatikios et de ses troupes en lui faisant croire que les barons avaient les
plus mauvais desseins contre lui et son empereur , puis, après son
départ, il l’accusa de lâcheté (1964). D’autre part il
cherchait à se faire promettre la possession d’Antioche par les chefs croisés
et, malgré les résistances qu’il rencontra d’abord, il finit par arriver à ses
fins lorsqu’on apprit que l’armée turque de Kerboga, émir de Mossoul, venait
délivrer Antioche : le 29 mai 1098 le conseil des chefs décida que si
Bohémond parvenait à se faire livrer la ville, elle lui appartiendrait : le 3 juin la
ville était prise, grâce aux intelligences que Bohémond s’y était
ménagées ; le 5 juin
l’armée de Kerboga paraissait sous ses murs et les croisés y étaient à leur
tour assiégés ; dans la nuit du
10 juin plusieurs croisés, découragés, s’échappèrent de la ville et parmi eux
se trouvait le comte Étienne de Blois .
Ce fut ces déserteurs qu’Alexis Comnène,
qui marchait sur Antioche, rencontra à Philomelion : ils lui annoncèrent
que la situation des croisés était désespérée, et Alexis, craignant une
nouvelle invasion des Turcs en Asie Mineure, battit en retraite et fit dévaster
le pays sur son passage pour couper les vivres à l’envahisseur . Cependant, par leur
brillante victoire du 28 juin 1098, les croisés avaient dégagé Antioche et
détruit l’armée de Kerboga , mais la discorde ne
tarda pas à diviser les chefs et le parti opposé à Bohémond, dirigé par le
comte de Toulouse, fit envoyer une ambassade à Alexis, pour lui annoncer la
prise de la ville et l’inviter à venir en prendre possession, en lui demandant
de se joindre à eux pour marcher sur Jérusalem .
La question d’Antioche. — Le résultat de
ces événements fut un changement complet dans la politique d’Alexis instruit de
la mainmise de Bohémond sur Antioche, il se réconcilia avec Raimond de
Saint-Gilles, devenu tout à coup le défenseur des droits impériaux . Lorsque la réponse du
basileus à leur ambassade leur parvint en mars 1099, les croisés se trouvaient
à la frontière de Palestine, à Arqa près de Tripoli, et la marche décisive sur
Jérusalem allait commencer : depuis le début de l’année Bohémond, mal
réconcilié avec Raimond, était retourné à Antioche où il agissait en prince
souverain . Dans sa réponse aux
croisés, Alexis enjoignait à Bohémond d’évacuer cette ville et annonçait son
arrivée pour la Saint-Jean prochaine si on lui remettait Antioche ; mais,
malgré les efforts du comte de Toulouse, le conseil fut d’avis de ne pas
l’attendre et la marche sur la Ville Sainte continua . Le 15 juillet suivant,
les croisés prenaient Jérusalem, mais la guerre entre Bohémond et l’Empire
avait déjà commencé .
Ce fut d’abord l’attaque de Laodicée
(Latakieh) que Raimond de Toulouse, après s’en être emparé, avait remise à
l’Empire . Malgré l’appui de la
flotte pisane commandée par l’archevêque Daimbert, Bohémond ne put prendre la
ville , mais il fit un coup de
maître en se rendant en pèlerinage à Jérusalem avec Baudouin d’Édesse, en usant
de son influence pour faire déposer le patriarche Arnoul de Robez et lui substituer
Daimbert et se faire conférer par lui l’investiture d’Antioche, qui légitimait
son pouvoir (janvier 1100). Dès le
mois de juin suivant il reprenait son offensive et constituait avec méthode le
territoire de sa principauté aux dépens de l’émir d’Alep et des dynastes arméniens
de Cilicie , quand, au cours d’une
expédition entreprise pour défendre le gouverneur arménien de Mélitène contre
l’émir de Siwas, il fut fait prisonnier (août 1100) .
Malgré ce désastre, l’œuvre de Bohémond ne
périt pas. Tancrède, son neveu, prit la régence d’Antioche et, continuant
l’offensive contre Alexis, lui reprit Tarse, les places de Cilicie et de Petite
Arménie et assiégea Laodicée,
qui se rendit après un siège de 18 mois (1102). Le comte de Toulouse étant
tombé entre ses mains, il ne le remit en liberté qu’après l’avoir obligé par un
serment solennel à abandonner toute prétention sur Antioche . L’empereur fut incapable
de faire face à cette offensive, étant occupé pendant toute l’année 1101 par
les nouvelles bandes de croisés qui traversèrent l’Empire successivement :
croisades des Lombards (mars-avril), du comte de Blois et des Allemands (juin),
du comte de Nevers (août), de Guillaume IX d’Aquitaine et de Welf de Bavière.
Toutes ces armées furent d’ailleurs détruites pendant leur traversée de l’Asie
Mineure par Qilidj Arslan et les autres émirs turcs .
La guerre entre Bohémond et l’Empire. — A la nouvelle
de la captivité de Bohémond, Alexis avait cherché à se le faire livrer en
payant sa rançon à l’émir Malik-Ghâzi, mais le rusé Normand avait réussi à
démontrer à son vainqueur qu’il serait bien plus avantageux pour lui de traiter
avec les Francs qu’avec le basileus. En mai 1103 la rançon fut versée et un
traité d’alliance fut signé entre les Francs et l’émir danichmendite de
Siwas .
A peine délivré, Bohémond se fit remettre
Antioche et, allié à Baudouin du Bourg, comte d’Édesse , reprit l’offensive
contre les Musulmans (été de 1103), imposa un tribut à l’émir d’Alep ;
mais en voulant protéger Édesse contre l’émir de Mossoul, il subit une grande
défaite à Rakka sur l’Euphrate, où Baudouin du Bourg fut fait prisonnier (mai
1104) . Tancrède parvint du
moins à sauver Édesse, dont il prit la régence, mais les Turcs d’Alep
profitèrent des embarras de Bohémond pour reprendre les territoires qu’ils
avaient perdus ; les villes de Cilicie chassèrent les Normands et reçurent
des garnisons byzantines, tandis que Cantacuzène s’emparait du port de
Laodicée .
Dans ces conjonctures Bohémond prit le
parti de confier de nouveau Antioche à Tancrède et de partir pour l’Occident, afin
d’en ramener des renforts et d’y organiser une croisade contre Alexis
Comnène .
Ce séjour en Occident dura plus de 2 ans et
demi (janvier 1105-octobre 1107). Non seulement Bohémond passa de longs mois en
Pouille pour équiper une armée et une flotte, mais il parcourut la France, où
il fut l’objet d’un accueil triomphal, fut reçu par le roi Philippe Ier,
dont il épousa une bâtarde, assista à un concile et partout, accompagné d’un
légat pontifical, se livra à une véritable guerre de propagande contre Alexis
Comnène et l’Empire byzantin. Ce voyage devait être d’une extrême importance.
Il fut le point de départ d’un mouvement d’opinion hostile à Byzance. Bohémond
accrédita l’idée que l’Empire byzantin trahissait la chrétienté et était le
principal obstacle à la réussite d’une croisade, thèse qui fut recueillie dans
les chroniques déjà rédigées, sous la forme d’interpolations tendancieuses
Cet immense effort aboutit à un formidable
échec. Bohémond voulut recommencer la campagne de 1081, débarqua avec ses forces
à Avlona (9 octobre 1107), puis brûla ses vaisseaux et commença le siège de
Durazzo Alexis avait levé de
nombreuses troupes et fait alliance avec Qilidj Arslan qui, depuis la perte de
Nicée, avait établi sa résidence à Iconium . Résolu à ne pas livrer
bataille aux Normands, il les harcela, incendia leurs machines de siège, bloqua
leur camp et les réduisit à la famine. Au moment où ses soldats commençaient à
déserter, Bohémond capitula et signa le traité désastreux de Deabolis, par
lequel il se reconnaissait l’homme-lige d’Alexis en acceptant de recevoir en
fief du basileus Antioche et une partie de son territoire, de faire prêter
serment à l’empereur par ses vassaux et d’accepter à Antioche un patriarche de
rite grec envoyé par Constantinople (septembre 1108) . Mais Alexis ne devait
pas recueillir le fruit de sa victoire : de retour en Italie, Bohémond y
mourut le 6 mars 1111 et Tancrède qui,
pendant l’absence de son oncle, avait rétabli les affaires de la principauté
d’Antioche et repris la plupart des places perdues , considéra le traité de
Deabolis comme nul et non avenu. Ce fut en vain qu’Alexis essaya d’organiser
contre Tancrède une coalition de tous les princes francs Tancrède mourut en 1112
après avoir assuré la défense d’Antioche, qu’il confia à son cousin Roger de Salerne
en réservant les droits du fils de Bohémond encore enfant .
Les dernières campagnes d’Alexis Comnène. — Jusqu’à ses
derniers moments Alexis Comnène eut à défendre les frontières de l’Empire, mais
il trouva aussi le temps de réorganiser l’administration des territoires d’Asie
Mineure recouvrés : ils comprenaient
le duché de Trébizonde, une partie du thème Arméniaque, la partie occidentale
de l’Anatolie limitée à l’est par une ligne allant de Sinope à Philomelion et
la côte méridionale avec le port d’Attalie. Mais les émirs turcs ne s’étaient
pas résignés à la perte de ces provinces. En 1113 Alexis dut repousser une
attaque sur Nicée ; en 1115-1116 ce
fut une tentative du nouveau sultan d’Iconium, Malek-Schah II, pour reprendre
les provinces du Nord. Alexis lui infligea une grosse défaite à la suite de
laquelle il signa un traité de paix avantageux pour l’Empire . En Europe Alexis dut
prendre des mesures pour arrêter une invasion imminente des Comans, mais il
suffit d’une démonstration militaire à Vidin pour leur faire repasser le
Danube . Enfin la place importante
que les républiques italiennes tenaient déjà dans l’Empire apparaît dans les
rapports assez tendus qu’Alexis Comnène eut avec les Pisans. Un accord conclu avec
eux par son ambassadeur (18 avril 1116) n’ayant pas été ratifié , Constantinople fut menacée
d’une attaque des flottes génoise et pisane et le basileus s’empressa de
conclure avec Pise un nouveau traité par lequel il s’engageait à ne mettre
aucun obstacle aux croisades pisanes et accordait à cette république des
privilèges commerciaux .
Ces concessions peuvent se rattacher aux
efforts faits par Alexis à la fin de son règne pour améliorer ses relations
avec l’Occident et en particulier avec Rome. Il ne semble pas que le clergé de
Constantinople ait été représenté au concile tenu à Bari en 1098 par Urbain II
en vue d’arriver à un accord avec les Grecs sur la procession du
Saint-Esprit , mais au même moment le
basileus était en relations épistolaires des plus cordiales avec l’abbé du
Mont-Cassin Oderisius et protestait de ses bonnes dispositions envers les
croisés . En 1102 il profitait
du passage à sa cour de l’évêque de Barcelone pour le charger de saluer le
nouveau pape Pascal II et de le justifier des calomnies portées contre lui par
certains croisés . Mais cet évêque
s’acquitta mal de sa mission et se répandit en accusations contre Alexis. C’est
ce qui explique l’accueil que Bohémond reçut de Pascal II en 1105, qu’il acheva
de persuader de la félonie du basileus.
La politique occidentale. — Cependant les
circonstances rapprochèrent le pape d’Alexis. Résolu à imposer au Saint-Siège
la doctrine séculière des investitures, Henri V était descendu en Italie, avait
emprisonné Pascal II et l’avait obligé à le couronner empereur (12 février
1111) . D’autre part, après la
mort du duc Roger Ier et celle de Bohémond, l’Italie normande était
gouvernée par trois régentes au nom d’enfants mineurs . Alexis Comnène vit là
une occasion favorable de reprendre pied en Italie et il écrivit une lettre au
peuple romain dans laquelle il manifestait son indignation contre
l’emprisonnement du pape et se déclarait prêt à venir à Rome recevoir la
couronne impériale (janvier 1112) . Les Romains répondirent
par une ambassade qui l’invitait à accomplir ce dessein (mai 1112) et un mois après Alexis
proposait au pape un projet de réunion des Églises que Pascal II acceptait
en demandant la réunion d’un concile . Mais, comme toujours,
dès que la question passa du plan diplomatique au plan théologique, l’entente
parut impossible : les discussions qui eurent lieu à Constantinople entre
l’archevêque de Milan, Pierre Chrysoloras, et les évêques Eustratios de Nicée
et Nicolas de Méthone n’aboutirent à aucun résultat et l’idée du concile fut
abandonnée .
Tels sont les derniers événements du règne
d’Alexis Comnène, qui mourut le 15 août 1118, âgé de 70 ans, après un règne de
37 ans et 4 mois. Il avait trouvé l’Empire en voie de dissolution et il en
avait refait un État puissant : il avait reconstitué son armée et sa
marine, écarté les invasions qui menaçaient Constantinople et recouvré une
grande partie des provinces perdues pendant les guerres civiles. Pourtant, ainsi
qu’on l’a fait remarquer, l’État qu’il a laissé à ses successeurs différait
entièrement par sa structure de l’État centralisé de l’époque macédonienne.
C’est avec les forces féodales, avec la noblesse terrienne, que ses
prédécesseurs avaient combattues, qu’il a organise l’État nouveau, et c’est ce
qui explique la fragilité de sa reconstruction .
4. L’Œuvre des Comnènes à son apogée (1118-1180)
Des souverains remarquables, Jean et Manuel
Comnène, fils et petit-fils d’Alexis, surent non seulement continuer son œuvre
de restauration, mais porter l’Empire à un haut degré de puissance. Avec un
véritable esprit de suite ils pratiquèrent sa politique dynastique à
l’intérieur, recherchèrent comme lui des alliances en Occident et montrèrent la
plus grande activité en Orient, en essayant de reprendre l’Asie Mineure aux
Turcs et d’établir leur suzeraineté sur les dynastes arméniens de Cilicie et
les principautés franques de Syrie, en particulier sur celle d’Antioche.
La succession d’Alexis Comnène. — Ce ne fut pas
sans difficulté que Jean Comnène succéda à son père. Des huit enfants d’Alexis
et d’Irène, Anne était l’aînée et bien qu’elle n’eût que 5 ans à la naissance
de son frère en 1088, Jean ne l’en avait pas moins privée du trône qu’elle
devait partager avec le fils de Michel VII, Constantin Doukas. Plus tard elle
avait épousé Nicéphore Bryenne, créé César, mais elle ne se consola jamais
d’avoir perdu le premier rang dans l’État et, lorsque Alexis fut à ses derniers
moments, il se trama dans la famille impériale un véritable complot, à la tête
duquel était l’impératrice Irène, pour évincer l’héritier légitime et lui
substituer Anne et son époux . Ce n’est d’ailleurs
pas Anne Comnène, mais le chroniqueur Zonaras qui a tracé un tableau saisissant
du drame qui se joua pendant l’agonie d’Alexis au palais des Manganes :
l’impératrice et ses filles entourant le moribond, celui-ci au courant de
l’intrigue et n’osant se prononcer, mais remettant en cachette son anneau
sigillaire à Jean Comnène, qui court aussitôt se faire couronner à
Sainte-Sophie, force l’entrée du Grand Palais et s’y retranche plusieurs jours,
sans même assister aux obsèques de son père . Et ce n’était pas
fini : quelques mois plus tard Anne Comnène organisait un complot pour
assassiner son frère, qui se contenta de confisquer les biens des conjurés et
d’enfermer sa sœur dans un monastère où l’impératrice Irène la rejoignit .
L’empereur Jean Comnène. — Jean, qu’on a
appelé « le plus grand des Comnènes » fut par ses qualités
morales, son humanité, son souci du devoir, la tenue de sa conduite, une des
plus belles figures parmi les empereurs qui régnèrent à Byzance . Agé de 30 ans à son
avènement, il avait épousé vers 1108 une princesse hongroise, Irène, qui lui
donna 4 fils et 4 filles. Il associa au trône l’aîné de ses fils, Alexis, qui
devait mourir avant lui , On a peu de renseignements
sur son gouvernement intérieur. Comme son père il confia les dignités et les
hauts emplois à des membres de sa famille, mais il n’eut guère à se louer de
son frère Isaac, qui essaya de le détrôner en 1130, après s’être enfui chez les
Turcs, et qui fit sa soumission en 1138 . Son fils Jean, qui
s’était soumis avec son père, déserta en pleine guerre l’armée impériale sous
un futile prétexte et s’enfuit à Iconium où il se fit musulman et épousa une
fille du sultan . Le règne de Jean Comnène
fut marqué par de magnifiques fondations religieuses, dont la plus importante
fut le monastère du Pantocrator auquel était attaché un hôpital modèle, dû à la
libéralité de l’empereur . Mais, militaire avant
tout, Jean Comnène dont le règne fut « une perpétuelle
campagne » , s’appliqua comme son
père à développer l’armée impériale, à en assurer le recrutement indigène et
l’entraînement et il lui donna comme
chef, avec le titre de Grand Domestique d’Orient et d’Occident, Jean Axouch,
ancien musulman, fait prisonnier au siège de Nicée par les croisés en 1097 et
élevé à la cour d’Alexis en même temps que l’héritier du trône qui, devenu
empereur, lui accorda toute sa confiance .
Affaires extérieures. — A l’extérieur
Jean Comnène suivit d’abord les directives paternelles, mais, grâce aux
minorités des princes normands des Deux-Siciles et au peu d’activité sur les
autres fronts, il put reporter tous ses efforts sur la reconquête des provinces
d’Orient occupées par les Turcs, les Arméniens et les croisés.
Dans la péninsule des Balkans il eut à
repousser une incursion des Petchenègues qui, depuis leur désastre de 1091,
avaient fini par reconstituer leur horde (1121-1122) , puis, probablement
sous l’influence d’Irène, il intervint dans la querelle de succession de
Koloman, roi de Hongrie, et accueillit un prétendant au trône, frère du défunt,
ce qui lui valut une guerre avec le fils de Koloman, Étienne II (1128) . Il semble bien qu’à
cette époque le Danube soit redevenu la frontière de l’Empire . Jean Comnène intervint
aussi dans les guerres civiles qui éclatèrent chez les Serbes après la mort de
Constantin Bodin et en 1123, d’abord, puis en 1137, opposa des prétendants à
Georges, fils de Bodin, qui finit par être pris et envoyé à Constantinople.
L’unité serbe était rompue par la séparation de la Dioclée et de la Rascie, qui
devint le principal centre de résistance à l’Empire et se trouva faire cause
commune avec la Hongrie après le mariage de la fille du joupan Ourosch avec le
roi de Hongrie Béla II .
L’un des événements importants du règne de
Jean Comnène fut la rupture de l’alliance vénitienne qui avait été le pivot de
la politique d’Alexis Comnène dans l’Adriatique. Probablement avec l’illusion
que le danger normand était passé, Jean essaya de s’affranchir du lourd tribut
que l’État byzantin payait au commerce vénitien sous la forme d’exemptions ou
de réductions de droits de douane ainsi que de privilèges de toutes sortes.
Lorsqu’à son avènement le doge lui demanda de renouveler les traités conclus
avec Alexis, Jean refusa, et Venise riposta par des incursions et des pillages
dans les îles de l’Archipel et sur les côtes dalmates (1124-1125) et par
l’occupation de Céphalonie (1126). Jean Comnène n’ayant pas une marine
suffisante pour résister à Venise, laquelle d’autre part voyait son commerce
avec l’Empire ruiné, les deux parties négocièrent et Jean renouvela tous les
privilèges accordés aux Vénitiens par son père .
La politique orientale. — Éloigner les
Turcs de l’Anatolie, rétablir l’autorité impériale sur les dynastes arméniens
de Cilicie, imposer cette autorité aux princes francs d’Antioche, tels furent
les buts essentiels de l’activité extérieure de jean Comnène. A son avènement
trois États musulmans étaient voisins des territoires d’Asie Mineure recouvrés
par Alexis : Maçoûd, sultan d’Iconium, menaçait la vallée du Méandre et la
plaine de Dorylée où ses sujets nomades trouvaient les pâturages nécessaires à
leurs troupeaux ; Malik-Ghâzi,
l’émir danichmendite de Siwas, convoitait les ports de la mer Noire ;
Toghroul Arslan, fils de Qilidj Arslan, émir de Mélitène, attaquait les possessions
byzantines de Cilicie. L’Empire occupait le duché de Trébizonde, les côtes de
la mer Noire et la partie occidentale de l’Anatolie ; à l’est et en
Cilicie, la frontière avait reculé et la route terrestre d’Attalie était
coupée .
Dès son avènement Jean Comnène résolut
d’entreprendre une rectification des frontières et attaqua le sultan d’Iconium.
En 1119, pendant que le duc de Trébizonde intervenait dans les querelles entre
les émirs, il s’empara de Laodicée qui commandait la haute vallée du Méandre et
en fit une puissante forteresse L’année suivante il
prenait Sozopolis, située entre la vallée du Méandre et les plateaux d’Anatolie
il rétablissait les communications terrestres avec Attalie . Les querelles
intestines des Turcs favorisaient ces entreprises. En décembre 1124 Malik-Ghâzi,
aidé de son gendre Maçoûd, sultan d’Iconium, s’emparait de Mélitène, dont
l’émir Toghroul se réfugiait à Constantinople . Un peu plus tard Jean
Comnène accueillait Maçoûd, renversé par Arab, son frère, puis en 1127 Arab
lui-même, après le rétablissement de Maçoûd à Iconium avec l’aide de
Ghâzi . Au milieu de cette anarchie,
la puissance accrue sans cesse du Danichmendite, soit dans la vallée de
l’Euphrate, soit dans la direction du Pont où un gouverneur byzantin, Kasianos,
lui livrait la côte de Paphlagonie , devenait menaçante
pour l’Empire. Jean Comnène entreprit plusieurs expéditions contre Ghâzi
(1132-1135) : la forteresse de Qastamouni en Paphlagonie fut prise et
reprise plusieurs fois, mais resta finalement au basileus, qui s’empara aussi
de Gangres en Galatie et, après la mort de Ghâzi, gagna à son alliance son
gendre Maçoûd . L’Empire recouvrait
ainsi tout le littoral de la mer Noire, du Bosphore au fleuve Tchorok à l’est
de Trébizonde ; maître de toutes les côtes d’Asie Mineure, il redevenait
une puissance maritime de premier ordre.
Suivant imperturbablement le plan qu’il
semblait avoir arrêté d’avance, Jean Comnène s’attaqua aux princes arméniens de
Cilicie qui se maintenaient indépendants entre les Turcs, l’Empire et les États
francs, du Taurus à l’Euphrate. Le plus puissant était Léon, de la famille des
Arsacides, qui s’était emparé de Tarse, Adana et Mopsueste et menaçait le port
de Séleucie . En avril 1137 une
puissante armée impériale, qui avait traversé l’Asie Mineure, se concentra à
Attalie où l’empereur arriva par mer : toutes les places occupées par Léon
tombèrent successivement et lui-même se réfugia dans le Taurus avec ses fils,
mais ce fut seulement l’hiver suivant, après la campagne d’Antioche, que Léon
et les siens furent capturés et emmenés à Constantinople .
Jean Comnène crut alors pouvoir accomplir
son grand dessein, qui était l’exécution du traité imposé à Bohémond à
Deabolis : restitution à l’Empire d’Antioche et de la principauté
d’Édesse, sa vassale . Il avait d’abord
essayé de résoudre la question d’une manière pacifique par le mariage de son
fils Manuel avec Constance d’Antioche, héritière de la principauté depuis la
mort de son père Bohémond II, tué dans une rencontre avec les troupes de Ghâzi,
en 1130 . La mère de Constance,
Alix, était favorable à cette union, mais le roi de Jérusalem, Foulque d’Anjou,
maria Constance à Raimond, fils de Guillaume IX, comte de Poitiers . Jean Comnène estima
que ses droits de suzerain avaient été violés, mais il trouva en outre un autre
motif d’intervention dans la menace que faisait peser sur les États francs
Imad-ed-dîn-Zengî, atabek et gouverneur de
Mossoul, qui s’emparait de la place forte de Montferrand, dans laquelle
s’étaient réfugiés le roi de Jérusalem et le comte de Tripoli, au moment même
où l’armée de Jean Comnène paraissait devant Antioche (août 1137).
Cette défaite rendait précaire la situation
des États francs aussi après quelques négociations, Raimond de Poitiers
capitula et alla rendre hommage au basileus, qui fit son entrée solennelle dans
la ville et arbora sa bannière sur la citadelle . L’année suivante,
usant de ses droits de suzerain, Jean Comnène fit faire la semonce à ses
vassaux francs et entreprit avec eux une expédition contre Alep, dont il ne put
s’emparer. Il échoua de même devant la place forte de Schaiar sur 1’Oronte et,
après un siège de trois semaines (26 avril-21 mai 1138) , il revint à Antioche,
qu’il fut obligé d’évacuer à la suite d’une émeute provoquée par Josselin
d’Édesse ;
il rentra ulcéré à Constantinople, tandis que Zengî reprenait les places qu’il
avait remises aux princes francs .
Cependant le basileus dut différer sa
vengeance. L’attaque soudaine contre les frontières d’Anatolie de l’émir
danichmendite Mohammed, fils de Ghâzi (1139), l’obligea à une nouvelle campagne
contre les Turcs, qui furent repoussés ; mais il voulut poursuivre l’émir
sur son territoire et détruire la forteresse qu’il avait élevée à Néocésarée.
Il échoua entièrement et dut lever le siège au bout de six mois (décembre 1140).
La mort de Mohammed, suivie d’une querelle
de succession, lui fit abandonner cette entreprise, mais il ne fut pas plus
heureux lorsqu’il reprit ses projets sur Antioche, dont il voulait faire un
apanage pour son fils Manuel en y joignant Chypre et Attalie . Après avoir
reconstitué son armée, très éprouvée par sa malheureuse campagne du Pont, il se
présenta devant Antioche (hiver de 1142) ; il s’en vit refuser l’entrée
et, ne pouvant en faire le siège, il prit ses quartiers d’hiver en Cilicie,
bien décidé à agir vigoureusement contre les Francs au printemps suivant et à se rendre à
Jérusalem pour imposer sa suzeraineté au roi Foulque, auquel il avait offert
son aide contre les Musulmans mais qui accueillit ses ouvertures sans
enthousiasme .
Il ne devait réaliser aucun de ces
projets : blessé d’une flèche empoisonnée au cours d’une chasse, il expira
le 8 avril 1143 , laissant inachevée
l’œuvre de restauration de la puissance impériale à laquelle il avait consacré
toute son activité.
Le réveil de la puissance normande. — Parmi les
questions qui avaient occupé ses dernières années, l’une des plus graves était
la nouvelle menace des Normands d’Italie contre l’Empire. Par suite des
divisions et de l’anarchie des États normands après la mort de Bohémond, du duc
de Pouille Roger Ier et du grand-comte Roger de Sicile, laissant des
enfants mineurs et des vassaux indociles, la plus grande sécurité régna de ce
côté jusqu’en 1127. A cette date l’héritier du duché de Pouille étant mort sans
enfant, son cousin, Roger II de Sicile, majeur depuis 1112, réussit à s’emparer
de la Pouille et de la Campanie, malgré le pape Honorius II, obligé, après une
expédition malheureuse contre lui, de lui en donner l’investiture . Par la soumission des
vassaux de Pouille et la reconnaissance de la suzeraineté de Roger par le
prince de Capoue (1129) , l’unité des États
normands se trouva reconstituée sous l’autorité d’un prince jeune et actif,
doué d’une ambition insatiable et de qualités administratives et militaires de
premier ordre. A la faveur du schisme pontifical , il se fit reconnaître
roi de Sicile par Anaclet II et ceignit la couronne dans la cathédrale de Palerme
(25 décembre 1130) . Dès 1123 il avait
cherché à prendre pied en Afrique en intervenant dans les querelles des princes
zirides d’El-Médeah .
Ces progrès rapides inquiétèrent Jean
Comnène qui redoutait une intervention de Roger dans les affaires d’Antioche et
accéda à la coalition formée contre le nouveau roi de Sicile et le pape Anaclet
par l’empereur Lothaire, le pape Innocent II, les vassaux de Pouille révoltés
et Venise, que soutenait l’éloquence de saint Bernard, principal défenseur
d’Innocent II . Ce fut avec les
subsides de Jean Comnène que Lothaire put descendre en Italie en 1137, occuper
les États continentaux de Roger avec l’aide de ses vassaux révoltés et faire
investir le beau-frère du roi, Rainolf d’Alif, du duché de Pouille par Innocent
II .
Ces succès ne furent qu’éphémères :
Lothaire mourut dans le Tyrol avant son retour en Allemagne (4 décembre
1137) , tandis qu’après son
départ Roger reparaissait en Italie avec une armée de Sarrasins et recouvrait
la Pouille en châtiant ses vassaux rebelles . Après la mort
d’Anaclet (25 janvier 1138), Innocent II excommunia Roger et dirigea en
personne une expédition contre lui, mais fut battu et fait prisonnier sur le
Garigliano (22 juillet 1139). Traité avec les plus grands égards, il dut passer
par toutes les volontés de son vainqueur et le reconnaître comme roi de Sicile,
duc de Pouille et prince de Capoue (25-27 juillet 1139) .
Une nouvelle puissance menaçante pour
l’Empire byzantin s’élevait dans l’Italie méridionale et, avant d’entreprendre
sa dernière expédition en Syrie, Jean Comnène négociait avec le nouvel empereur,
Conrad III de Hohenstaufen, un traité d’alliance contre Roger : un plan
d’attaque des Deux-Siciles fut concerté et la belle-sœur de Conrad, Berthe de
Sulzbach, fut fiancée au quatrième fils de Jean Comnène, Manuel , qui, les deux aînés
étant morts, devint de par la volonté de son père l’héritier du trône, bien que
son frère Isaac fût plus âgé que lui .
Manuel Comnène (1143-1180). — Manuel, que sa
naissance ne destinait pas d’abord au trône et qui se trouvait à Attalie au
moment où Jean Comnène le désigna comme son héritier, lui succéda cependant
sans difficulté . Par son caractère il
offrait un contraste saisissant avec son père et il ne paraît pas avoir joui du
bel équilibre des facultés morales et intellectuelles de Jean Comnène. Peu
flatté de devenir le gendre d’un comte allemand, il s’efforça de rompre ses fiançailles
avec Berthe de Sulzbach et il fallut que Conrad III le menaçât d’abandonner son
alliance contre Roger pour le décider à l’épouser . De mœurs peu sévères,
il défrayait par ses aventures nombreuses les conversations de Constantinople
et l’aspect de la cour, austère sous Jean Comnène, prit un caractère
frivole . De plus Manuel, non
content d’acquérir les qualités nécessaires à un homme d’État, prétendait à un
savoir encyclopédique et se mêlait de toutes les disciplines, théologien
aventureux, dont les initiatives effrayaient le clergé , médecin et chirurgien
à l’occasion , astrologue,
n’entreprenant rien sans consulter le ciel , mais de plus excellent
soldat, passionné pour les exercices du corps et les exploits guerriers et
sportifs , enfin chef de guerre
émérite, excellent diplomate, homme d’État aux idées audacieuses, guidé par
l’idée de l’empire universel . Et ce qui rend sa figure
encore plus complexe, c’est son engouement, très rare à Byzance, pour les
Occidentaux et leurs coutumes, recherchant pour lui-même et les siens des
unions matrimoniales avec eux, non seulement les admettant dans son armée et
ses administrations civiles, mais imposant à ses soldats l’armement de leurs
chevaliers et instaurant la mode de leurs tournois, auxquels il prenait part
lui-même .
Tel fut le brillant souverain qui essaya de
réformer l’État et de restaurer
l’empire universel, mais en dépit de ses qualités et de son activité
prodigieuse, il ne put suffire aux tâches nombreuses et compliquées que lui
imposait sa politique. Désireux de réussir à tout prix, il n’épargna ni son
trésor ni ses sujets aussi laissa-t-il à sa mort des finances en désordre, un
empire épuisé et le prestige impérial compromis.
La dernière offensive de l’Empire. — L’erreur de
Manuel est d’avoir cru que les circonstances lui permettaient de rendre à
l’Empire son antique puissance. Jean Comnène avait su limiter le champ de son
action : les ambitions de Manuel embrassaient l’Orient et l’Occident, ce
qui l’obligea à étendre ses entreprises sur les théâtres les plus éloignés et à
se heurter à des États bien organisés et redoutables par leur puissance navale
et militaire. En vrai Byzantin, Manuel crut qu’il pourrait neutraliser ses
ennemis par des alliances et pratiquer une politique d’équilibre : venir à
bout des Normands par son alliance avec Venise et l’Empire germanique, de
l’Empire germanique par son alliance avec les papes et les communes lombardes,
des Turcs par les États francs et arméniens placés sous sa suzeraineté, qu’il
voulait étendre à la Hongrie et à la Serbie. Or cette politique de grand style
était trop étendue pour les forces dont il disposait et il ne put obtenir que
des succès partiels, mais peu solides.
De son avènement à la croisade générale
(1143-1148), Manuel oriente sa politique. Il se brouille avec Raimond, prince
d’Antioche, et fait ravager son territoire (2078) et repousse une
tentative de rapprochement de Roger II . Lorsque l’atabek de
Mossoul, Zengî, s’empare d’Édesse (23 décembre 1144) , Manuel humilie à
plaisir Raimond de Poitiers, qui vient implorer son secours, et refuse de
soutenir les États francs en péril, perdant ainsi l’occasion de devenir le chef
de la croisade . En 1146 Zengî était
assassiné et Josselin en profitait pour rentrer à Édesse, mais ne pouvait s’y
maintenir devant les attaques du fils de Zengî, Nour-ed-dîn, qui lui enlevait
le reste de son territoire .
Insensible à ces événements, Manuel était
tout entier à ses projets contre le sultanat de Roum et la Sicile. Allié à
l’émir danichmendite de Siwas, il dirigea deux expéditions contre le sultan
Maçoûd (1144-1146), et parvint jusqu’à Iconium, dont il se contenta de ravager
les faubourgs ; mais à l’approche de la croisade il fit la paix avec
Maçoûd (1147) . A ce moment Manuel
méditait une attaque contre le roi de Sicile avec l’appui de Conrad III . La prédication de la
croisade par saint Bernard à la nouvelle de la chute d’Édesse, vint bouleverser
tous ces plans. La participation de Conrad III à la guerre sainte, décidée
brusquement à la diète de Spire (25 décembre 1147), en interdisant à l’empereur
germanique d’attaquer Roger II, fut un véritable désastre pour la politique de
Manuel et rendit les mains libres au roi de Sicile, ulcéré contre Byzance ; mais la
tentative qu’il fit pour engager le roi de France à venir s’embarquer sur ses
navires fut repoussée et la croisade suivit la vieille route continentale qui
aboutissait à Constantinople .
Manuel prit les mêmes mesures pour convoyer
les croisés que son aïeul Alexis un demi-siècle plus tôt . Cependant l’année 1147
fut terrible pour l’Empire. Le passage des bandes indisciplinées de Conrad III
eut des résultats désastreux . L’armée du royaume de
France, commandée par Louis VII, se comporta mieux, mais dans l’entourage du
roi on ne parlait que d’une attaque de Constantinople . Et pendant que Conrad
se faisait battre par les Turcs à Dorylée et, que Louis VII et
son armée étaient transportés d’Attalie à Antioche par une escadre impériale , ce fut le moment que
Roger II choisit pour assouvir ses rancunes contre Byzance.
Pour renforcer la garnison de
Constantinople Manuel avait dégarni de troupes la Grèce et les îles ; sa
flotte surveillait les côtes d’Asie Mineure et de Syrie. Bien renseigné, Roger
II, à la différence de Bohémond, entreprit une expédition purement maritime,
mais, et c’était là une nouveauté, avec un but plus économique que militaire.
Sa flotte, devenue la plus puissante de la Méditerranée, montée par des
équipages et des soldats en partie musulmans, était commandée par un Christodoulos,
Sarrasin converti, par un Georges d’Antioche, Grec transfuge, ancien ministre
d’un prince ziride d’Afrique . En fait c’était avec
les anciens ennemis de Byzance, les Sarrasins de Sicile unis aux Normands, que
Roger allait envahir l’Empire.
Dans l’été de 1147 la flotte de Roger
s’empara facilement de l’île de Corfou avec la complicité des habitants, puis
doubla le Péloponnèse, occupa Nauplie, pilla les côtes de l’Eubée et débarqua
dans le golfe de Corinthe des troupes qui marchèrent sur Thèbes, centre
important du tissage de la soie, et emmenèrent en captivité les ouvrières en
soie. Après avoir pillé Corinthe, grande place commerciale où étaient entassées
de nombreuses marchandises, les Normands revinrent en Sicile avec un immense
butin sans que Manuel ait pu leur opposer la moindre résistance . L’industrie de la
soie, déjà florissante à Palerme, prit un nouvel essor, grâce à la déportation
des ouvrières thébaines, et surtout Byzance fut privée d’une branche
d’industrie fructueuse, au grand bénéfice de ses concurrents siciliens .
Cependant la deuxième croisade avait dévié
de son but, qui était la délivrance d’Édesse, et le roi de Jérusalem, Baudouin
III, l’avait entraînée sur Damas (juillet 1148), dont les croisés pillèrent les
magnifiques vergers, mais ne purent entreprendre un siège en règle , et ce fut de conserve
avec la flotte normande que le navire qui portait Louis VII navigua jusqu’à la
côte de Calabre (juillet 1149) . Cette expédition avait
aggravé le malentendu entre Byzance et les Occidentaux, convaincus que l’Empire
byzantin était le principal obstacle à la délivrance des lieux saints.
Mais, depuis le départ de la croisade,
Manuel ne songeait plus qu’à tirer vengeance de Roger et à le réduire à
l’impuissance. Pendant onze ans, de 1147 à 1158, il s’engagea à fond contre le
roi de Sicile, concluant une nouvelle alliance avec Venise dont il étendit les
privilèges commerciaux (octobre 1147, mars 1148) , renouvelant ses
traités avec Conrad III, qui promit d’attaquer Roger (25 décembre 1149) , allant lui-même
diriger la reprise de Corfou (hiver 1348-1349) , enfin portant la
guerre en Italie, grâce à son occupation d’Ancône (1151) et à son alliance avec
les vassaux normands de Pouille . Ce fut en vain que
Roger II chercha à organiser une nouvelle croisade contre Byzance avec l’appui
de saint Bernard et de Suger : la diplomatie de Manuel contrecarra la
sienne avec succès .
Mais, à la veille de tenir sa promesse,
Conrad III mourut, le 15 février 1152, et son neveu Frédéric Barberousse, qui
lui succéda et qui avait l’ambition de rétablir l’autorité de l’Empire
d’Occident en Italie, voyait d’un mauvais œil l’ingérence de Manuel Comnène
dans la péninsule .
Cependant Manuel ne perdit pas tout espoir
de s’entendre avec Frédéric, retenu en Allemagne par des difficultés intérieures.
Au cours de l’année 1153 plusieurs ambassades furent échangées entre les deux
princes ; il fut même question
d’un mariage entre Frédéric et la fille du sébastocrator Isaac , mais l’entente sur les
conditions politiques de l’alliance paraissait impossible , quand la mort de Roger
II, le 26 février 1154, vint brusquement modifier la situation . Son fils Guillaume Ier,
couronné roi de Sicile dans la cathédrale de Palerme le 4 avril suivant, envoya
une ambassade à Manuel demander la paix en offrant de restituer le butin fait
en Grèce. Moins que jamais Manuel entendait renoncer à rétablir la puissance
byzantine en Italie : il répondit par un refus et dans son aveuglement
il crut pouvoir compter sur l’alliance de Frédéric Barberousse, dont les ambitions
ne pouvaient que heurter les siennes. Couronné empereur à Rome par Hadrien IV,
le 18 juin 1155, Frédéric fit cependant bon accueil à l’ambassade que Manuel
lui envoya à Ancône et il était disposé à envahir 1’Apulie lorsque l’opposition
de la plupart de ses vassaux l’obligea à battre en retraite vers le nord .
Devant cette défection Manuel se décida à
agir seul. Son principal agent diplomatique et militaire en Italie, Michel
Paléologue, se mit en rapport avec les vassaux normands révoltés et envahit la Pouille
avec une armée de mercenaires. Les enseignes byzantines reparurent sur Bari,
Trani, Barletta (août-septembre 1155) . Le pape Hadrien IV
lui-même acceptait des subsides de Manuel et levait une armée qui envahissait
le royaume normand . Michel Paléologue mourut
après avoir pris plus de 50 villes ou forteresses et son successeur Jean Doukas
poussa ses opérations jusqu’à Tarente et Brindisi , mais ce fut dans cette
dernière ville, dont la citadelle tenait toujours, que la fortune abandonna
Byzance. Une grande victoire de Guillaume Ier sur Doukas lui permit
de rétablir son autorité sur ses vassaux tandis que les Grecs battaient en
retraite jusqu’à Ancône et que le pape, assiégé dans Bénévent, faisait la paix
avec les Normands . Une attaque victorieuse
de la flotte normande sur l’Eubée (printemps de 1157) , décida Manuel à
traiter avec Guillaume Ier .
Parallèlement à cette action en Italie,
Manuel avait été obligé d’entreprendre en personne une expédition contre la
Serbie révoltée avec l’appui du roi de Hongrie Geiza II (1149-1150) , qu’il attaqua avec
succès après sa victoire sur les Serbes (1151) , mais il fallut encore
deux expéditions en 1152 et en 1156, suivies de deux traités, pour obliger
Geiza à cesser ses intrigues et ses attaques contre l’Empire . Les Serbes n’étaient
pas plus respectueux que les Hongrois des engagements qu’ils avaient pris. En
1161 Manuel déposa le grand joupan Pervoslav Ourosch et en 1163 il le remplaça
par son frère Dessa, qu’il obligea à céder à l’Empire, en échange de cette
dignité, les domaines qu’il possédait près de Nisch . Dessa, plus connu sous
le nom d’Étienne Nemanja, devait être le libérateur de la Serbie.
En Cilicie et en Syrie les résultats acquis
par Jean Comnène étaient gravement compromis. D’une part les Arméniens se
révoltaient sous un chef national, Thoros, qui s’emparait de la plupart des
places byzantines (1152) ; d’autre part les
États francs étaient menacés par l’alliance de Nour-ed-dîn avec le sultan
d’Iconium, Maçoûd , et, au mépris de la suzeraineté
byzantine, Constance d’Antioche, veuve de Raimond de Poitiers, refusait
d’épouser le beau-frère de Manuel et se remariait avec un simple chevalier
d’Occident, Renaud de Châtillon . Manuel fit cependant
bon visage au nouveau prince d’Antioche et le poussa à attaquer Thoros (1154),
mais le basileus ayant refusé de lui verser les sommes promises, Renaud s’allia
avec Thoros et se jeta sur l’île de Chypre qu’il mit à feu et à sang
(1156) .
Ce fut seulement en 1158 que Manuel, libre
du côté de l’Occident, put aller rétablir son autorité dans ces régions. Son
expédition fut une véritable promenade militaire : Thoros s’enfuit à son
approche et Renaud vint en suppliant, la corde au cou, reconnaître la
suzeraineté du basileus , que le roi de
Jérusalem Baudouin III, venu à Antioche, paraît avoir reconnue aussi .Avant de regagner
Constantinople, Manuel conclut une trêve avec Nour-ed-dîn qui lui restituait
des milliers de prisonniers . L’année suivante,
1160, après une expédition de Manuel Comnène en Asie Mineure, le sultan
d’Iconium Qilidj Arslan II signait, à son tour, un traité qui faisait de lui un
vassal de l’Empire : il vint en personne à Constantinople où il reçut de
Manuel un accueil magnifique (1162) .
Manuel est alors à l’apogée de sa puissance :
en paix avec les Normands et Frédéric Barberousse, il a relevé le prestige de
l’Empire en Orient et obtenu des résultats qu’avaient en vain cherchés son père
et son aïeul, en particulier la suzeraineté effective de la Syrie franque. En
1161 il épousait en secondes noces Marie d’Antioche, sœur du prince Bohémond
III .
Il comblait de ses largesses les églises de Terre Sainte, et les mosaïques de
la basilique de Bethléem exécutées en 1178 étaient accompagnées d’inscriptions
où son nom figurait avant celui du roi de Jérusalem . Il semblait que
l’Orient allait repasser sous la domination byzantine, mais, grisé par ses
succès et poursuivant la chimère de la domination universelle, Manuel conçut de
trop grands desseins qui firent péricliter sa politique orientale.
La succession de Hongrie. — Les affaires
de Hongrie l’occupent de 1161 à 1173. Après la mort de Geiza, Manuel soutient
le frère du défunt, Étienne IV, qui revendique la couronne d’après la loi
turque, comme étant le collatéral le plus âgé, contre son neveu Étienne III,
fils de Geiza . En fait Manuel se souciait
moins de la personne de son prétendant, impopulaire en Hongrie, que de
l’intérêt qu’il y avait à placer la Hongrie comme la Serbie sous l’autorité de
l’Empire et à la forcer à restituer la Sirmie et la Dalmatie . Aussi Étienne IV ayant
été battu par son neveu près de Belgrade (19 juin 1162) et obligé de se
réfugier dans l’Empire , Manuel l’abandonna
sans aucun scrupule et conclut avec Étienne III un traité, d’après lequel son
jeune frère Béla fut envoyé à Constantinople et fiancé à Marie, fille du
basileus : dans la pensée
de Manuel, qui n’avait pas d’héritier masculin, ce jeune prince devait être
l’instrument futur de sa politique hongroise.
Mais en livrant son frère, Étienne III
avait retenu son apanage, la Sirmie et la Dalmatie, et il fallut pour l’amener
à résipiscence une expédition de Manuel en territoire hongrois et la médiation
du roi de Bohème Ladislas qui permit la signature d’un nouveau traité (fin
1163-1164) . Deux fois encore, en
1165 et en 1166, Étienne III viola ses promesses. En 1165 Manuel organisa une
véritable coalition contre la Hongrie afin de rétablir Étienne IV , mais celui-ci mourut empoisonné
par son neveu, au moment où Manuel s’emparait de la forteresse de Semlin et
forçait Étienne III à conclure un nouveau traité En 1167 une expédition
commandée par Kontostephanos infligea une grande défaite aux Hongrois devant
cette même place de Semlin , On ignore si un nouveau
traité fut conclu, mais ce qui est certain, c’est que l’Empire resta en
possession de la Dalmatie et d’une partie de la Croatie .
Étienne III mourut en 1173 et une troupe
impériale alla installer son frère Béla III comme roi de Hongrie. Marie
d’Antioche lui ayant donné un fils en 1169, Manuel avait abandonné l’idée de
lui léguer la couronne impériale, mais il se fit céder des avantages importants
par son protégé . La même année Manuel
dut conduire une expédition en Serbie pour réprimer les menées d’Étienne Nemanja,
qu’il avait créé archijoupan et qui, après avoir attaqué les chefs serbes vassaux
de Byzance, s’était allié avec Venise contre l’Empire, avait envahi la Dalmatie
et battu une armée impériale (1171-1172) . Étienne dut se rendre
à merci et fut emmené à Constantinople .
La couronne impériale d’Occident. — Manuel avait
en somme réussi à rétablir l’unité de la péninsule des Balkans sous la
domination impériale et à étendre son autorité même au-delà du Danube, mais il
poursuivait en même temps un dessein plus grandiose : rétablir l’unité de
l’Empire romain en déterminant le pape à poser sur sa tête la couronne
impériale d’Occident. Un chapitre de Kinnamos, montrant que certains rois
d’Occident ont commis une usurpation en prenant le titre d’empereur et en
s’arrogeant le droit de nommer les papes, correspond vraisemblablement à la
doctrine officielle qui régnait dans l’entourage de Manuel .
Sans être découragé par les échecs qu’il
avait subis en Italie, Manuel suivait avec attention les affaires d’Occident et
guettait l’occasion d’y reprendre pied à la faveur de la querelle du Sacerdoce
et de l’Empire, qui commença sous Hadrien IV après la diète de Besançon (1157)
et atteignit son point culminant sous le règne d’Alexandre III, entre 1159 et
1177 .
C’est ce qui explique l’excellent accueil fait par Manuel aux ouvertures de ce
pape qui lui demande son alliance contre Frédéric Barberousse , et la correspondance
suivie qu’il entretient entre 1159 et 1163 avec le roi de France, Louis
VII .
Ces pourparlers aboutirent à un nouveau projet d’union des Églises en échange
de laquelle Manuel demandait pour lui la couronne impériale . Le pape envoya deux
légats à Constantinople, mais ce fut quand on essaya d’en arrêter les modalités
que l’on comprit tout ce que ce projet avait de chimérique : sans que l’on
sache exactement pour quelles raisons, les négociations furent abandonnées
(1167) .
A partir de ce moment la politique
occidentale de Manuel Comnène se compliqua de plus en plus et prit un caractère
incohérent. II ne perdit jamais contact avec Alexandre III et continua à avoir
avec lui des relations cordiales . Cherchant partout des
ennemis à Frédéric Barberousse, il continua à occuper Ancône, soutint par ses
subsides la révolte de la Ligue des Villes lombardes (1167-1168) et agit par des
négociations laborieuses sur les républiques de Pise, Gênes et Venise pour les
décider à prendre parti contre l’empereur germanique (1167-1170). Et pourtant
il n’a pas absolument rompu avec Frédéric et lui demande son appui dans les
affaires de Hongrie : de 1159 à 1170 il y eut des échanges d’ambassades
entre les deux princes et même un projet de mariage entre la fille de Manuel et
le fils de Barberousse , puis en 1173
l’empereur allemand ouvrait les hostilités en assiégeant Ancône qui fut
défendue avec succès par les Lombards , et poussait le sultan
d’Iconium à attaquer l’Empire .
Non moins contradictoire fut la politique
de Manuel vis-à-vis du royaume de Sicile. Après la mort de Guillaume Ier (7 mai 1166) il proposa à la régente Marguerite la main de sa fille, devenue
une véritable pièce de l’échiquier diplomatique, pour l’héritier du trône,
Guillaume II . Le projet fut
abandonné, Manuel songea même à attaquer la Sicile , puis, se ravisant en
1171, proposa de nouveau sa fille à Guillaume II, qui accepta et alla attendre
sa fiancée à Tarente où elle devait arriver au printemps de 1172, mais ce fut
en vain qu’il l’attendit : Manuel avait encore changé d’avis et Guillaume
II se retira outré de l’injure qui lui était faite et qui devait avoir de
fâcheuses suites pour l’Empire .
Plus désastreuse encore par ses
conséquences fut la rupture subite de Manuel avec Venise, dont les intérêts en
Dalmatie étaient opposés à ceux de l’Empire , mais que sa haine de
Barberousse avait maintenue jusque-là dans l’alliance byzantine. Après une
période de tension pendant laquelle les Vénitiens rompirent toute relation
commerciale avec l’Empire et émigrèrent en masse , Manuel leur tendit un
véritable piège en les engageant à revenir avec la promesse éventuelle de leur
céder le monopole du commerce dans ses États . Alléchés par cette
perspective, 20 000 Vénitiens regagnèrent leurs entrepôts et le 12 mars
1171 Manuel les faisait arrêter et confisquait tous leurs biens . Venise équipa aussitôt
une flotte qui enleva plusieurs villes dalmates et débarqua des troupes en
Eubée. Manuel demandant à négocier, la flotte vénitienne alla occuper l’île de
Chio et pendant que le basileus faisait traîner les pourparlers en longueur, la
peste se mit dans les équipages vénitiens ; après trois tentatives inutiles
d’entente avec Manuel, la flotte regagna Venise . Lasse d’être jouée par
Manuel, Venise se rapprocha de Barberousse et conclut un traité d’alliance avec
le roi de Sicile . Manuel se décida alors
à de nouvelles négociations et, après de nouveaux échanges d’ambassades, signa
la paix avec Venise en 1175 , mais la République
conserva un souvenir amer du traitement infligé à ses nationaux.
Jusqu’à la fin de son règne, en dépit des
échecs qu’il rencontra en Asie, Manuel continua à s’occuper des affaires
d’Occident. Après la défaite du basileus à Myriokephalon et celle de
Barberousse à Legnano (1176), les deux souverains vaincus, l’un par le sultan
d’Iconium, l’autre par les milices lombardes, échangèrent des lettres
aigres-douces . Ayant appris le soulèvement
des Lombards contre les mesures prises par l’envoyé de Frédéric, Christian,
archevêque de Mayence, après le traité de Venise, Manuel se mit en rapport avec
les mécontents, en particulier avec Guillaume de Montferrat auquel il donna des
fiefs, et dont le fils, Renier, vint épouser à Constantinople la fille de
Manuel, si souvent fiancée à d’autres princes, et reçut la dignité de César
(février 1180) . Un mois plus tard
Manuel faisait célébrer le mariage du fils que lui avait donné Marie
d’Antioche, Alexis II, âgé de onze ans, avec la fille du roi de France Louis
VII, Agnès, elle-même dans sa huitième année . Ce fut son dernier
succès diplomatique, mais les résultats de sa politique occidentale étaient
déplorables : il laissait l’Empire brouillé avec les Hohenstaufen, avec la
Sicile, avec Venise, et ses sujets eux-mêmes exaspérés par son engouement pour
les Occidentaux.
La croisade dirigée par Byzance (1168-1171). — Engagé au même
moment contre la Hongrie et en Occident, Manuel poursuivait en outre un
troisième dessein grandiose : la reconquête de l’Orient musulman avec les
États francs de Syrie et les croisés d’Occident comme auxiliaires, en fait la
croisade dirigée par Byzance et dans l’intérêt de Byzance.
Il avait réussi à placer les États francs
de Syrie sous son protectorat et à exercer une pleine autorité à Antioche, dont
le prince, Bohémond Ill, fait prisonnier et remis en liberté par Nour-ed-dîn en
1165, était allé à Constantinople, où il épousa une princesse de la famille
impériale et d’où, conformément au traité de 1159, il ramena un patriarche
grec, Athanase, qui y resta jusqu’à sa mort en 1171, tandis que le patriarche
latin Amaury avait dû quitter la ville .
Mais à ce moment, un grand danger menaçait
les colonies franques. Maître d’Alep et de Damas, Nour-ed-dîn cherchait à
introduire son autorité en Égypte à la faveur de l’anarchie qui régnait dans le
califat. La dégénérescence de la dynastie fatimite avait livré l’État aux
compétitions des vizirs d’où la guerre civile en permanence . Le gouverneur du Saïd,
Abou-Schouga Schawer, s’étant révolté, s’empara du pouvoir en 1162, mais chassé
d’Égypte l’année suivante, il se réfugia dans les États de Nour-ed-dîn, qui
profita de cette occasion pour intervenir en Égypte : son meilleur
général, Schirkoûh, vint rétablir Schawer (1164), mais les deux alliés ne
tardèrent pas à se brouiller et Schawer, menacé d’être renversé, invoqua le
secours du roi de Jérusalem, Amaury Ier, qui avait succédé à son
frère Baudouin III en 1162 et dirigé une première
expédition en Égypte dès 1163 . Frappé du danger que
courraient les États chrétiens si Nour-ed-dîn parvenait à s’implanter dans la
vallée du Nil, Amaury n’hésita pas à intervenir. Une première fois les forces
réunies d’Amaury et de Schawer forcèrent Schirkoûh à abandonner l’Égypte
(1164) , mais il l’envahissait
de nouveau en 1167 avec l’intention de se venger de Schawer. Aussitôt Amaury
accourut avec une nouvelle armée, lui barra la route du Caire, lui infligea une
défaite décisive en Haute Égypte, l’assiégea dans Alexandrie et l’obligea à
capituler (août) et à signer un traité qui établissait un véritable protectorat
franc sur l’Égypte avec un corps d’occupation au Caire et le paiement d’un
tribut annuel par Schawer en échange de cette protection, puis Schirkoûh et
Amaury évacuèrent l’Égypte .
Ce fut alors qu’Amaury, comprenant qu’il
disposait de forces insuffisantes pour conserver sa position en Égypte et faire
face aux attaques de Nour-ed-dîn, fit appel à Manuel Comnène. Obligé de
divorcer pour cause de parenté d’avec Agnès de Courtenay, il avait fait
demander au basileus la main d’une princesse impériale et, à son retour
d’Égypte, le 29 août 1167, il épousa à Tyr une petite-nièce de Manuel . Peu après il envoyait
à Constantinople une ambassade dirigée par le futur historien Guillaume de Tyr,
qui rejoignait le basileus en Serbie. Manuel, qui avait déjà sauvé Antioche des
attaques de Nour-ed-dîn, saisit cette nouvelle occasion de rendre encore plus
efficace son protectorat sur les États francs et de diriger la croisade au
profit de Byzance : il ramena les ambassadeurs à Constantinople et signa
avec eux un traité d’alliance qui prévoyait un partage de l’Égypte .
Mais, et ce fut là une grosse faute, Amaury
poussé par des conseillers, et en particulier le grand-maître de l’Hôpital,
n’attendit pas l’arrivée des forces byzantines pour attaquer l’Égypte. Tout en
négociant avec l’armée franque, arrivée devant les murs du Caire, Schawer avait
envoyé un message à Nour-ed-dîn en proposant de lui céder un tiers de l’Égypte.
L’Atabek envoya aussitôt Schirkoûh, qui, accompagné de son neveu, Saladin
(Salah-ed-Dîn,) et d’une troupe d’élite, évitant l’armée franque qui battait en
retraite à son approche, arriva au Caire à marches forcées (décembre 1168), fit
égorger Schawer qui avait comploté contre lui (18 janvier 1169) et mourut
lui-même d’une indigestion le 23 mars suivant ; mais le jeune
calife fatimite choisit pour lui succéder comme grand-vizir son neveu Saladin
qui établit son autorité par la terreur . Par la faute d’Amaury
l’Égypte était au pouvoir de Nour-ed-dîn et son chef réel, Saladin, allait devenir
l’adversaire le plus dangereux rencontré jusque-là par les États chrétiens.
Cependant, conformément au traité signé
avec Amaury, Manuel Comnène faisait de grands préparatifs pour attaquer
l’Égypte. En juillet 1169 le mégaduc Andronic Kontostephanos partait avec une
forte escadre pour Chypre et, après des pourparlers assez longs avec Amaury,
aborda à Tyr, où arriva la flotte de celui-ci (fin septembre). Les alliés
avaient décidé d’attaquer Damiette, qui fut assiégée du 27 octobre au 4
décembre 1169. La mésentente entre Andronic et Amaury entravait les opérations
et, au moment où le mégaduc donnait l’ordre de l’assaut, le roi venait de
signer un armistice avec la garnison, qui capitula. Les troupes byzantines se
rembarquèrent dans le plus grand désordre pendant que les Francs rentraient en
Syrie . Le résultat de cette
malheureuse échauffourée fut de renforcer le pouvoir de Saladin en Égypte et de
rendre plus précaire la situation des États chrétiens attaqués en même temps
par Nour-ed-dîn et par Saladin . Des ambassadeurs
envoyés par Amaury en Occident pour solliciter le départ d’une nouvelle
croisade revinrent en 1171 après n’avoir obtenu que de vagues promesses de secours .
Force fut donc à Amaury de se retourner
vers Manuel, mais, afin d’éviter les malentendus qui avaient fait échouer
l’expédition contre Damiette, il se rendit lui-même à Constantinople en vue
d’arrêter, d’accord avec le gouvernement impérial, le plan d’une nouvelle
attaque de l’Égypte. Il y reçut l’accueil somptueux et empressé que Manuel
réservait aux princes de la Syrie franque et conclut avec le basileus un
nouveau traité d’alliance, dont on ignore entièrement les clauses et que les circonstances
devaient rendre stérile. Nour-ed-dîn mourut à Damas le 15 mai 1174, à la veille
de l’expédition qu’il préparait pour arracher l’Égypte à Saladin , qui profitait des
difficultés et de l’anarchie entraînées par sa succession pour s’emparer de
Damas (novembre 1174) et préparer ainsi l’unité du front musulman contre les
États chrétiens .
Mais déjà Amaury lui-même était mort le 11
juillet 1174, à l’âge de 38 ans, en laissant comme héritier un enfant de 13
ans, Baudouin IV, atteint de la terrible maladie de la lèpre et les barons de
Jérusalem se disputaient le gouvernement du royaume . Manuel Comnène ne
renonça cependant pas à son projet de croisade. Dès 1165 il l’annonçait au pape
Alexandre III en lui demandant d’encourager les fidèles à prendre la croix et en 1177 il envoyait
une ambassade à Baudouin IV pour l’inviter à exécuter le traité conclu par son
père .
De plus une flotte de 70 navires, destinés à l’attaque de l’Égypte, fut envoyée
à Saint-Jean-d’Acre : le roi et les barons étaient favorables au projet
d’expédition, mais le comte de Flandre, Philippe d’Alsace, venu en pèlerinage à
Jérusalem et à qui Baudouin IV, dont il était parent, avait remis la direction
de l’État, refusa d’en prendre le commandement et s’opposa à ce qu’il fût
confié à Renaud de Châtillon, délivré de sa captivité . Non seulement
l’expédition fut ajournée, mais l’alliance byzantine, qui pouvait encore sauver
les États chrétiens, fut abandonnée .
Cet écroulement de son grand dessein
n’avait cependant pas découragé Manuel. Le pape Alexandre III lui ayant annoncé
qu’une nouvelle croisade générale, commandée pat le roi Louis VII, suivrait la
route terrestre et traverserait l’Empire, Manuel lui envoya une ambassade pour
lui exposer les conditions auxquelles il accorderait libre passage aux croisés
(mars 1080) : le pape devait adjoindre un cardinal à la croisade et
garantir la restitution à l’Empire des villes qui lui avaient appartenu avant
leur occupation par les Turcs ; en échange Manuel s’engageait à travailler
à l’union des Églises . Jusqu’à la veille de
sa mort il fut hanté de l’idée de faire servir la croisade à la restauration de
la puissance impériale en Orient.
La dernière offensive contre le sultan
d’Iconium.
— Dans l’intervalle Manuel avait essayé de ramener à l’observation de ses
devoirs envers l’Empire le sultan d’Iconium, Qilidj Arslan, qui, pendant qu’il
était absorbé par ses entreprises en Hongrie et en Égypte, avait agrandi son
État aux dépens des émirs danichmendites et menaçait de s’allier avec
Nour-ed-dîn contre les États francs de Syrie. En 1173, Manuel lui ayant
reproché ses négociations avec les ennemis de l’Empire, le sultan consentit à
renouveler les traités , puis, au début de
1175, il le somma de restituer les villes qu’il avait enlevées à
l’Empire : Qilidj y consentit, mais excita sous main leurs habitants à
résister aux troupes envoyées pour en prendre possession . Devant cette mauvaise
foi Manuel mit la frontière en état de défense, rassembla une armée importante
et au printemps de 1176, alors qu’il envoyait en Égypte une véritable armada,
il envahit la Phrygie et marcha sur Iconium, mais ayant engagé imprudemment son
armée dans le défilé de Myriokephalon, situé aux sources du Méandre, il y subit
une défaite écrasante et la plus grande partie de ses troupes fut massacrée. Il
fut trop heureux de signer le traité aux conditions modérées que lui fit
proposer son vainqueur . Les frontières de
l’Empire n’étaient pas modifiées mais deux forteresses qui les défendaient, Dorylée
et Soublaion, devaient être démantelées. Manuel laissait la situation en Asie
Mineure moins bonne qu’à son avènement : au lieu de plusieurs émirs divisés
entre eux, l’Empire aurait désormais affaire à un unique mais puissant État.
5. La chute de l’Empire romain hellénique (1180-1204)
Les derniers événements du règne de Manuel
Comnène, qui mourut le 24 septembre 1180 après une courte maladie , avaient montré la
fragilité de son œuvre. Après la faillite de ses grands desseins, il laissait
l’Empire entouré d’ennemis extérieurs et troublé à l’intérieur. En Occident,
Frédéric Barberousse s’était relevé de ses désastres et son prestige était plus
grand que jamais , tandis que le roi de
Sicile n’attendait qu’une occasion d’apaiser ses rancunes contre l’Empire
byzantin et que l’idée d’une croisade contre les Grecs, considérée comme le
seul moyen d’assurer l’avenir des États francs de Syrie, se répandait de plus
en plus. En Orient s’élevait la puissance de Saladin, maître de l’Égypte et de
la Syrie musulmane, enserrant de tous côtés les États chrétiens livrés aux
discordes et à l’indiscipline des princes francs.
A l’intérieur de l’Empire régnait un
violent mécontentement contre les exactions fiscales qui avaient été pour
Manuel le seul moyen de soutenir sa politique de prestige, mais les esprits
étaient surtout irrités par la place que les Occidentaux tenaient dans l’État,
et la richesse des colonies italiennes, en possession d’un véritable monopole
commercial, suscitait d’irrémissibles haines. Les provinces étaient agitées et
leurs gouverneurs indisciplinés : il s’y dessinait, surtout dans les populations
allogènes, un mouvement centrifuge des plus inquiétants.
Et pour faire face à ces difficultés Manuel
laissait après lui un enfant de onze ans, Alexis II, sous la tutelle de sa
mère, Marie d’Antioche, détestée comme étrangère, aussi mal vue des princes de
la famille impériale que de la noblesse et du peuple.
C’est cette situation qui explique que
l’histoire des vingt-quatre ans qui suivent la mort de Manuel soit celle de la
dissolution de l’Empire romain hellénique et des différentes étapes qu’il a dû
franchir avant d’aboutir à la catastrophe finale.
La régence de Marie d’Antioche (septembre
1180 - avril 1182). — Les pouvoirs de Marie d’Antioche reposaient
sur un acte de Manuel datant de l’association au trône d’Alexis II (4 mars
1171) et lui confiant la régence en cas de minorité à condition qu’elle
prendrait l’habit monastique . L’impératrice revêtit
donc la mandya sans cesser d’habiter le Palais et confia le pouvoir au protosébaste
Alexis Comnène, neveu de Manuel , vieux et insignifiant.
Le ministre et la régente échappèrent d’abord à un complot fomenté par la
porphyrogénète Marie Comnène et son époux, Renier de Montferrat, contre
lesquels ils n’osèrent prendre aucune sanction, mais qui, se sentant peu en
sûreté au Palais, se réfugièrent à Sainte-Sophie : comme on voulait les en
faire sortir de force, une violente émeute, qui fit de nombreuses victimes,
éclata le 2 mai 1171 avec la complicité du patriarche Théodose . On s’arrêta à un
compromis : la régente promit d’éloigner Alexis et d’ailleurs n’en fit
rien ; le César Renier et son épouse revinrent au Palais , mais lorsque Alexis
voulut exiler le patriarche, il y eut un nouveau soulèvement et il fallut le
laisser rentrer en triomphe à Constantinople . La situation
paraissait sans issue : ce fut alors qu’intervint un nouveau personnage,
Andronic Comnène.
Fils du sébastocrator Isaac, frère de Jean
Comnène, qui s’était réfugié chez le sultan d’Iconium, élevé avec son cousin
germain, le futur empereur Manuel, Andronic avait toujours été en désaccord
avec lui et avait passé la plus grande partie de son règne en disgrâce, en
prison et en exil. D’une grande intelligence, très instruit, charmeur et beau
parleur, mais entraîné à tous les exercices du corps, cavalier accompli, d’un
courage intrépide qui lui valait sa popularité dans l’armée, il joignait à ces
qualités brillantes une immoralité notoire et défrayait la chronique scandaleuse
de Constantinople par ses aventures amoureuses et sa liaison, bien que marié,
avec Eudokia, nièce de Manuel, dont la sœur était la maîtresse du
basileus . Manuel chercha à
l’employer en l’éloignant et le nomma en 1151 duc de Cilicie, mais il échoua dans
la mission qui lui fut confiée et, convaincu de complot
contre la vie de l’empereur, il fut arrêté en 1154 et jeté dans une prison du
Grand Palais, d’où il s’évada une première fois en 1158 et, ayant été repris,
définitivement en 1164. Il parvient alors à gagner la cour du grand prince
Iaroslav de Russie, d’où Manuel le rappelle ; il se réconcilie avec lui,
puis le renvoie dans son gouvernement de Cilicie (1166), mais ne tarde pas à le
destituer à cause de son inconduite . Andronic s’enfuit,
emportant le produit des impôts, gagne la Palestine, séduit à Saint-Jean-d’Acre
sa cousine Théodora, veuve de Baudouin III, la décide à le suivre, reçoit du
roi Amaury le fief de Beyrouth, apprend que Manuel a donné l’ordre de l’arrêter
et de lui crever les yeux et s’échappe avec Théodora (1167) .
Alors, pendant treize ans il mène la vie
errante d’un aventurier. On le trouve successivement à Damas, à Bagdad, en
Géorgie, à Mardin, à Erzeroum, puis chez un émir turc de l’ancien thème de
Chaldia, qui lui donne sur la frontière byzantine une forteresse où il mène la
vie d’un chevalier-brigand, détroussant les caravanes et pillant le territoire
impérial. Théodora ayant été capturée dans une de ces incursions et étant
tombée aux mains du duc de Trébizonde, Andronic implora sa grâce et Manuel la
lui accorda (juillet 1180). Avec une mise en scène peu sincère le rebelle vint
s’humilier aux pieds du basileus et lui prêta serment de fidélité ainsi qu’à
son fils Alexis II .
Manuel lui avait donné comme résidence une
ville de la mer Noire et ce fut de là qu’il
suivit attentivement les événements qui troublèrent Constantinople après la
mort du basileus. Renseigné par une de ses filles qui avait pu s’échapper de la
ville impériale et le rejoindre à Sinope, appelé par Marie la porphyrogénète,
il se décida à intervenir .
Révolte et usurpation d’Andronic (1182). — En prenant
pour prétexte le serment de fidélité qu’il avait prêté à Manuel et à Alexis II,
Andronic s’était contenté jusque-là d’adresser au jeune basileus et au patriarche
une lettre de protestation contre le désordre de la cour et le pouvoir
exorbitant du protosébaste , mais en même temps il
levait des troupes, et ses préparatifs terminés au printemps de 1182, il
s’avança sans résistance jusqu’à Nicomédie, mit en déroute l’armée d’Andronic
l’Ange, qui, après sa défaite fit défection, et arriva jusqu’à Chalcédoine, où
la flotte de Kontostephanos envoyée contre lui passa de son côté . Aux ouvertures de
compromis du protosébaste il répondit par un ultimatum : destitution
d’Alexis Comnène, entrée de la régente dans un monastère, et ce qu’il attendait
se produisit : le peuple de Constantinople se souleva, le protosébaste,
arrêté et jeté dans une barque, fut conduit devant Andronic qui le condamna à
avoir les yeux crevés . Mais l’émeute
déchaînée se porta sur les quartiers habités par les colonies latines, incendia
les établissements et massacra tous les Occidentaux qui n’avaient pu se
réfugier sur des navires. La haine longtemps contenue s’assouvit sauvagement.
Les prêtres et les moines grecs étaient les plus acharnés, et surtout contre
leurs confrères latins. Le cardinal Jean, légat d’Alexandre III, fut décapité
et sa tête attachée à la queue d’un chien. On alla jusqu’à égorger des malades
dans leur lit et à déterrer les morts dans les cimetières, et les troupes introduites
par Andronic dans la ville prêtaient main-forte aux émeutiers . Les navires latins qui
recueillirent les fugitifs et qui formaient une flotte imposante exercèrent
d’ailleurs des représailles sanglantes sur les côtes de l’Hellespont et de
l’Archipel . Le divorce entre
Byzance et l’Occident devenait ainsi irréparable.
Ce fut seulement au mois de septembre
qu’Andronic fit son entrée dans la Ville Impériale, non sans démonstrations
hypocrites de respect pour le jeune Alexis II et la mémoire de Manuel , puis, quand il se
sentit le maître, il donna libre cours à sa vengeance : la porphyrogénète
Marie et Renier de Montferrat furent empoisonnés par ses ordres ; Marie
d’Antioche, accusée d’avoir incité son beau-frère le roi de Hongrie à envahir
l’Empire, fut condamnée à mort et étranglée dans son cachot ; la plupart des
dignitaires du Palais et des fonctionnaires furent destitués et remplacés par
des hommes dont il était sûr ; le patriarche
Théodose, qui refusait de marier une bâtarde d’Andronic avec un bâtard de Manuel,
fut déposé et remplacé par une de ses créatures, Basile Kamateros . Ce fut seulement après
cette promotion, en septembre 1183, qu’Andronic, qui, à son arrivée à
Constantinople, avec un empressement affecté, avait fait couronner Alexis II à
Sainte-Sophie , se fit couronner
lui-même par le nouveau patriarche . Quelques semaines plus
tard l’infortuné fils de Manuel était étranglé dans son lit et Andronic, déjà
sexagénaire, épousait la fiancée de sa victime, Agnès de France, âgée de 11
ans .
Gouvernement d’Andronic. — Ayant ainsi
fait place nette Andronic entreprit la
réforme de l’Empire. Cet homme, qui par certains côtés ressemble à un sultan
sanguinaire et par d’autres annonce les tyrans de la Renaissance italienne,
était rempli de contradictions et méritait, d’après ses contemporains, les plus
grands éloges et les plus grands blâmes . Il voulait sincèrement
guérir les maux dus à la faiblesse de ses prédécesseurs et extirper jusqu’à la
racine la puissance exorbitante de la noblesse, mais il ne connaissait d’autre
moyen de gouvernement que la violence et la terreur . Les chroniqueurs comme
Nicétas, qui cependant ne le ménagent guère, son frère l’archevêque d’Athènes,
Michel Khoniates, font l’éloge de ses mesures : suppression de la vénalité
des charges, traitements réguliers assurés aux gouverneurs de provinces et aux
fonctionnaires, établissement de nouveaux registres d’impôts supprimant les
levées arbitraires, répression des abus des puissants, sécurité donnée aux
cultivateurs, suppression du droit d’épave, envoi dans les provinces de juges
réformateurs. « Le seul nom d’Andronic comme une parole magique mettait en
fuite les exacteurs avides . »
Ces mesures blessaient bien des
intérêts : en outre la personne même et les crimes du basileus excitaient
la plus grande horreur. Les deux années que dura son règne furent donc remplies
par une succession ininterrompue de conspirations et de révoltes des gouverneurs
de provinces qui avaient pris des habitudes d’indépendance refusèrent de le
reconnaître .
En 1184 il dut entrer en campagne pour
réprimer le soulèvement des principales villes d’Asie Mineure et il exerça
contre leurs habitants les plus cruelles représailles . La même année un neveu
par sa mère de Manuel Comnène, Isaac, gouverneur de Tarse, s’emparait de l’île
de Chypre, s’y faisait proclamer basileus : Andronic, ne pouvant
l’atteindre, se vengea sur les parents qu’il avait à Constantinople . Exaspéré par ces
révoltes, il fit régner la terreur dans la ville impériale et redoubla de
cruautés au point qu’il fut honni de ceux mêmes qui avaient salué son
avènement . Ce régime atroce ne
pouvait durer il suffit pour le renverser d’une secousse extérieure, l’attaque
des Normands.
Dans ses rapports avec l’étranger Andronic
prit en tout le contre-pied de la politique de Manuel. Sa haine contre
l’Occident s’étendait aux principautés franques de Syrie, et en 1185 il signa
avec Saladin un traité de partage des États chrétiens par lequel il s’engageait
à aider le sultan à conquérir la Palestine qu’il tiendrait en fief de
l’Empire . Il n’ignorait pas
qu’un orage menaçant se formait contre lui en Occident : les fiançailles
du roi Henri, fils de Barberousse, avec Constance, tante et héritière de Guillaume
II, roi de Sicile (29 octobre 1184), rapprochaient les deux principaux ennemis
de Byzance . Ce fut en vain
qu’Andronic essaya de se prémunir contre ces menaces en cherchant à se
rapprocher de Rome et en accordant un
traité avantageux à Venise . Guillaume II excité à
la guerre contre l’Empire par un neveu de Manuel, Alexis, échappé de l’exil où
il avait été relégué, avait en outre accueilli un jeune Grec que l’on faisait
passer pour Alexis II, échappé à la mort. Par l’importance des
effectifs qu’il réunit à Messine, ce fut une véritable croisade que Guillaume
II mena contre l’Empire avec le dessein avoué d’en faire la conquête .
L’expédition partit le 11 juin 1185 et ses
succès furent foudroyants : 24 juin, prise de Durazzo, tête de pont de la
Via Egnatia ; 6 août, arrivée devant Thessalonique de l’armée de terre,
rejointe par la flotte le 15 août ; 24 août, prise d’assaut de cette ville
malgré l’armée de secours envoyée par Andronic . La nouvelle de ce
désastre sema la panique à Constantinople : on sut que l’armée normande
continuait sa marche en avant et que la flotte cinglait vers les détroits, et
des murmures s’élevèrent contre l’incurie de l’empereur. Andronic, furieux,
ordonna le massacre des nombreux détenus qui remplissaient les prisons, mais
n’eut pas le temps de publier son édit . Le favori du basileus
ayant voulu arrêter un membre de la noblesse regardé comme suspect, Isaac
l’Ange, celui-ci le tua d’un coup de sabre et se réfugia à Sainte-Sophie, où il
fut rejoint par une foule de mécontents qui le proclamèrent empereur le
lendemain (11-12 septembre 1185) pendant que l’émeute grondait dans les
rues .
Andronic fugitif ne trouva pas un défenseur : pris à l’entrée de la mer
Noire au moment où il essayait de s’embarquer pour la Crimée, il fut conduit à
Constantinople et littéralement dépecé vivant par la populace en furie .
Le premier soin du nouvel empereur fut de
débarrasser l’Empire des Normands dont la flotte était embossée aux îles des
Princes et dont l’armée s’était dispersée pour piller la Thrace. Rejetés sur
Thessalonique après avoir subi un désastre au passage du Strymon, ils se
rembarquèrent en désordre . Mais ce fut seulement
quelques années plus tard qu’ils signèrent la paix, après avoir envoyé une
flotte soutenir la révolte d’Isaac Comnène à Chypre .
Les premiers symptômes de dissolution
(1185-1195). — Ce fut pendant la période de 19 ans qui sépara l’avènement
d’Isaac l’Ange de la croisade de Constantinople que commença l’œuvre de démolition
de l’Empire : lorsque l’édifice fut abattu, il était déjà ruiné à
l’intérieur. Les premiers symptômes de dissolution se manifestèrent sous le
règne d’Isaac l’Ange, dont l’avènement peut être considéré comme la victoire de
la noblesse sur la politique égalitaire d’Andronic, avec le même nationalisme
étroit vis-à-vis de l’Occident .
Par ses origines le nouveau basileus était
de noblesse récente, mais d’autant plus attaché à la classe où sa famille, qui
venait de Philadelphie en Asie Mineure, était entrée par le mariage de son
aïeul Constantin avec une fille de l’empereur Alexis Comnène . Dès lors, alliés de la
dynastie, les Anges occupèrent les plus hautes fonctions, en particulier sous
Manuel , et s’unirent à la
noblesse contre le despotisme d’Andronic, bien que le père d’Isaac, Andronic
l’Ange, chargé de combattre Andronic Comnène, ait été des premiers à se rallier
au prince rebelle. Fils aîné de cet Andronic l’Ange, Isaac passait pour
médiocre et insignifiant et ce fut peut-être pour cette raison qu’Andronic
Comnène l’épargna, bien qu’il eût soutenu contre lui la révolte de Nicée . A vrai dire, rien ne
l’avait préparé à la tâche redoutable qu’il avait assumée. Par son caractère
brouillon, par la vulgarité de ses goûts, par sa paresse, il était tout le
contraire d’un homme d’État , et à la différence des
Comnènes ses prédécesseurs, il n’avait aucune conception d’ensemble, aucun
programme défini, mais pratiquait une politique au jour le jour. Il n’avait pas
cependant le caractère faible qu’on lui a prêté âgé de 30 ans à son avènement,
il avait des goûts militaires et à plusieurs reprises il commanda lui-même ses
armées. Mieux qu’Andronic il en assura le recrutement, et on a vu qu’il réunit
dès le début de son règne des forces suffisantes pour chasser les Normands de
l’Empire .
Son gouvernement intérieur n’en fut pas
moins déplorable et son œuvre politique consista à restaurer les abus
qu’Andronic avait voulu déraciner. Il altéra les monnaies, augmenta les impôts,
vendit les magistratures et paya mal les fonctionnaires, qui se dédommagèrent
sur le peuple . Il avait confié
l’administration du trésor à son oncle maternel, Théodore Kastamonitès,
excellent financier, mais exacteur impitoyable, qu’il remplaça après sa mort
par des incapables et des concussionnaires qui achevèrent de ruiner le trésor
en satisfaisant les caprices dispendieux du prince .
Cette mauvaise administration ne pouvait
qu’engendrer des révoltes et encourager les mouvements séparatistes qui avaient
déjà commencé sous Andronic. Un impôt extraordinaire sur les troupeaux, établi
pour solder les frais du mariage d’Isaac avec une princesse hongroise, fut
l’occasion d’une révolte des bergers valaques des Balkans (1186).
L’insurrection s’étendit bientôt à toute la Bulgarie danubienne et fut dirigée
par deux boyards des environs de Tirnovo, Pierre et Jean Asên, dont les
réclamations avaient été repoussées par Isaac avec violence . Bulgares et Valaques
firent cause commune, allèrent chercher des secours au-delà du Danube chez les
Comans et firent alliance avec le joupan serbe Étienne Nemanja. Tirnovo, où fut
érigée une église dédiée à saint Démétrius, devint le centre de l’insurrection
et ce fut sans doute à ce moment que Pierre Asên prit le titre de tsar .
Après quatre campagnes (1186-1187) dont
deux dirigées par lui-même, Isaac put empêcher les rebelles d’envahir la Thrace
et leur infliger plusieurs défaites, mais il ne put venir à bout de leur
révolte , et de plus il eut à
combattre le général même qui venait en 1187 de les forcer à passer les
Balkans, Alexis Branas. Après sa victoire, ce personnage, qui en était à sa
seconde tentative d’usurpation , se fit proclamer
empereur par ses troupes et marcha sur Constantinople qu’il soumit à un
rigoureux blocus. La situation d’Isaac eût été désespérée sans l’intervention
de Conrad de Montferrat, de passage à Constantinople . Une charge de ses chevaliers
francs rendit victorieuse la sortie tentée par Isaac, et Conrad, s’étant battu
en duel avec Branas le perça de sa lance et lui coupa la tête, ce qui amena la
dispersion de l’armée rebelle .
Les Bulgares et les Valaques avaient
profité de cette diversion pour envahir de nouveau la Thrace. Isaac l’Ange
rentra en campagne, les força à battre en retraite en abandonnant leur butin,
puis au printemps de 1188 les poursuivit jusque dans la plaine de Sofia, mais
n’étant pas en état de soutenir une longue guerre, il leur accorda une trêve
qui leur abandonnait le pays situé entre le Danube et les Balkans . Les lettrés de
Constantinople qui connaissaient l’histoire de l’Empire regrettaient les jours
de Basile le Bulgaroctone, dont l’ouvre était ainsi compromise . La péninsule des
Balkans allait redevenir une mosaïque d’États indépendants, d’autant plus que
le joupan de Serbie, Etienne Nemanja, se considérant comme dégagé de ses
promesses après la mort de Manuel, avait repris sa marche envahissante et
favorisé l’insurrection vlacho-bulgare. Allié à Bêla III, roi de Hongrie, qui
avait essayé d’intervenir au moment de la révolte d’Andronic Comnène, pour
sauver Marie d’Antioche , Étienne Nemanja s’empara
en 1187 de la position importante de Nisch et chercha surtout à s’ouvrir un
chemin vers l’Adriatique en occupant la Dioclée et le territoire dalmate
jusqu’aux bouches de Cattaro . Isaac l’Ange ne trouva
d’autre moyen d’arrêter cette expansion serbe que de se rapprocher de Béla III,
dont il épousa la fille, Marguerite, en 1185 et avec lequel il conclut un
traité d’alliance dirigé contre les Serbes et les Bulgares .
Mais la vraie raison qui avait déterminé
Isaac l’Ange à traiter avec les Asên, malgré sa victoire, était l’ampleur que
prenait de plus en plus le mouvement séparatiste. Une expédition navale contre
Chypre 1186 se heurta à la flotte sicilienne envoyée par Guillaume II pour
défendre Isaac Comnène et subit un désastre complet . L’amiral normand
vainqueur, Margaritone, reçut en fief du roi de Sicile les territoires conquis
en 1185 qu’il possédait encore et resta en possession de Zante et de
Céphalonie .
En Asie Mineure Isaac l’Ange ne pouvait
venir à bout lui-même de la tentative de Théodore Mancaphas pour se créer un
État séparé comprenant Philadelphie et la Lydie et dut traiter avec lui :
il fallut l’intervention du duc des Thracésiens, Basile Vatatzès, pour faire
expulser l’intrus, qui se réfugia auprès du sultan d’Iconium et obtint de lui l’autorisation
de lever des troupes avec lesquelles il ravagea les provinces byzantines. Enfin
à prix d’argent le basileus obtint qu’il lui fût livré, mais cet épisode en dit
long sur l’impuissance de l’empereur et la désagrégation progressive de
l’Empire .
Le passage de la croisade allemande à
travers le territoire impérial allait lui porter le dernier coup. Lorsque,
après la prise de Jérusalem par Saladin (2 octobre 1187), Frédéric Barberousse
prit la croix à Mayence (27 mars 1188) il annonça à Isaac l’Ange son intention
de suivre route terrestre et de traverser l’Empire. Après des échanges
d’ambassades, un traité fut signé à Nuremberg (septembre 1188) par lequel Isaac
accordait libre passage à la croisade à condition que l’armée allemande
s’abstînt de toute violence ; mais quelques
semaines plus tard le basileus, décidé à empêcher la croisade allemande et à la
détruire, se mettait en rapport avec Saladin et concluait avec lui un traité
d’alliance De là son attitude
équivoque et sa politique perfide à l’égard des croisés. Lorsque Barberousse
atteignit le territoire de l’Empire (28 juin 1189), il trouva les chemins
interceptés, les convois de vivres arrêtés et il apprit que ses ambassadeurs à
Constantinople étaient emprisonnés .
Une pareille traîtrise ne pouvait
qu’engendrer l’inimitié et la violence. Bien qu’ayant reçu à Nisch une nouvelle
ambassade d’Isaac avec un message rempli de promesses , Frédéric s’y mit en
rapport avec tous les ennemis de l’Empire, reçut Étienne Nemanja qui profita du
conflit byzantino-allemand pour s’emparer de nouvelles forteresses
impériales et signa un traité
d’alliance avec les Vlacho-Bulgares . D’autre part le
conflit entre Isaac et Frédéric passa bientôt à l’état aigu. Le 16 août les
croisés durent enlever de vive force la passe de Trajan barrée par des troupes
impériales . Des correspondances
pleines de récriminations furent échangées entre les deux souverains et Isaac accusa
« le roi d’Allemagne » de vouloir s’emparer du trône de
Constantinople. En réponse Frédéric se mit à ravager la Thrace et à occuper des
forteresses en déclarant qu’il continuerait les hostilités jusqu’à la
libération de ses ambassadeurs .
Enfin l’historien Nicétas Khoniates, alors
gouverneur de Philippopoli, étant allé à Constantinople mettre le basileus au
courant de la situation (septembre), après plusieurs échanges
d’ambassades , Isaac se décida à
rendre aux envoyés allemands la liberté (19 octobre) , mais lorsque ceux-ci,
accompagnés de fonctionnaires byzantins, arrivèrent au camp allemand et eurent
mis leur souverain au courant des mauvais traitements qu’ils avaient subis, du
traité conclu entre Isaac et Saladin et des prédications haineuses du
patriarche, Frédéric se considéra comme en état d’hostilité avec l’Empire et marcha sur Andrinople
qu’il atteignit le 22 novembre, après un engagement sanglant avec les troupes
byzantines à Didymotika . En février 1190 les
Allemands étaient presque aux portes de Constantinople et occupaient la plupart
des places fortes de Thrace et de Macédoine orientale, après avoir incendié
Berrhoé et Philippopoli. En même temps Frédéric resserrait son alliance avec
les Serbes et les Vlacho-Bulgares, qui lui offraient de l’aider à conquérir
Constantinople .
Isaac l’Ange, se sentant perdu, essaya
d’abord d’amuser l’ennemi par des négociations traînées en longueur . Enfin, après deux mois
de pourparlers, il signa le traité d’Andrinople (février 1190) par lequel,
après avoir livré des otages, il s’engageait à faire passer les croisés en Asie
entre Gallipoli et Sestos, à leur assurer des vivres, à payer une indemnité aux
ambassadeurs retenus en captivité, à ne pas inquiéter ceux qui avaient aidé les
Allemands . C’était une capitulation
totale. Les croisés franchirent donc l’Hellespont (21-30 mars) et traversèrent l’Asie
Mineure, non sans qu’Isaac ait tenu Saladin au courant de leur marche . Attaqué par les Turcs,
Frédéric Barberousse prit d’assaut Iconium et conclut un traité avec Qilidj
Arslan . Son arrivée excitait
la terreur dans le monde musulman, mais le 10 juin 1190, marchant sur Tarse, il
se noya au passage du Selef et son armée découragée se dispersa .
Le passage de la croisade de Barberousse
avait, pourrait-on dire, révélé le secret de l’Empire byzantin et semblait
justifier l’opinion, courante depuis longtemps en Occident, que Byzance était
le principal obstacle à la réussite de la croisade. Dans une lettre adressée à
son fils, le roi Henri (16 novembre 1189), Frédéric lui enjoignait d’envoyer
aux Dardanelles les flottes des villes d’Italie et de demander au pape de faire
prêcher la croisade contre Constantinople : le traité
d’Andrinople fit abandonner le projet, mais la question était posée.
Après le départ de Barberousse, Isaac
l’Ange régna encore cinq ans, mais dans des conditions de plus en plus précaires.
Pendant le siège de Saint-Jean-d’Acre, il continua à manifester son hostilité
aux croisés et à correspondre avec Saladin, avec lequel il arrêta le plan d’une
expédition en commun contre l’île de Chypre, conquise sur Isaac Comnène par
Richard Cœur-de-Lion (mai 1191) et vendue par lui aux Templiers, puis à Guy de
Lusignan, le roi dépossédé de Jérusalem (mai 1192) .
Isaac l’Ange n’avait pas non plus abandonné
l’espoir de restaurer l’autorité impériale sur les peuples slaves des Balkans.
Aussitôt après le départ de la croisade allemande, il dirigea une expédition
contre Étienne Nemanja, le battit sur la Morava et l’obligea à signer un traité
par lequel il restituait à l’Empire ses conquêtes récentes, mais lui
garantissait les anciennes. Le deuxième fils du joupan serbe épousait une nièce
du basileus et était créé sébastocrator . Il fut moins heureux
avec les Vlacho-Bulgares qu’il alla attaquer chez eux en assiégeant Tirnovo,
mais une invasion subite des Comans l’obligea à battre en retraite et il subit
une grande déroute en repassant les Balkans . Les chefs d’armées
n’étaient d’ailleurs pas plus sûrs que ses ennemis : son cousin Constantin
l’Ange, gouverneur de Philippopoli, qui réussit à empêcher les Bulgares
d’envahir la Thrace, se crut autorisé par ses succès à se faire proclamer
empereur par ses soldats (1193) ; mais il fut arrêté à Andrinople et eut
les yeux crevés . Les Asên en profitèrent
pour passer les Balkans, ravager la Thrace, battant deux chefs impériaux près
d’Arcadiopolis (1194-1195). L’empereur, démuni de troupes, passa l’hiver à
lever péniblement une armée et demanda des secours à son gendre le roi de Hongrie . Il partit enfin en
campagne au printemps de 1195, mais ce fut pour être renversé par une
conspiration militaire, à la tête de laquelle était son propre frère Alexis,
qui fut proclamé basileus le 3 avril et n’hésita pas à faire crever les yeux à
Isaac et à l’emprisonner .
L’effondrement. — L’empereur Alexis III
acheva en 9 ans (1195-1204) de conduire l’Empire à sa perte. Isaac, malgré sa
médiocrité, avait au moins la conscience de ses devoirs et, s’il échoua dans la
plupart de ses entreprises, c’est que, quand il prit le pouvoir, la situation
de Byzance était déjà désespérée. Le principal trait du caractère de son
successeur est au contraire la frivolité. Élu basileus en pleine guerre, il ne
songe nullement à continuer l’expédition contre les Bulgares, mais distribue
aux soldats l’argent de la caisse militaire, les envoie en congé et revient à
petites journées à Constantinople, où sa femme Euphrosyne, ambitieuse et
autoritaire, fière d’avoir dans les veines du sang des Doukas, lui gagne des
partisans et lui prépare une entrée triomphale . Indifférent aux
affaires de l’Empire, il abandonna le pouvoir à l’impératrice et à son favori,
Constantin Mesopotamites ; et c’était ce qu’il pouvait faire de mieux, car
il les laissa faire sous son nom des réformes utiles, comme la suppression de
la vénalité des charges, mais il ne sut pas les soutenir contre les
intrigues : Euphrosyne, éloignée un moment de la cour, put recouvrer son
autorité, mais Constantin, qui était archevêque de Thessalonique, accusé de
crimes imaginaires, fut déposé par un synode et exilé .
L’empereur passait la plus grande partie de
son temps dans l’oisiveté, occupé de distractions futiles et ne faisait jamais
rien sans consulter les astres . Cependant les
événements désastreux qui se succédèrent l’obligèrent à sortir de sa torpeur. A
l’intérieur ce ne furent que désordres, émeutes, conspirations, apparitions
d’imposteurs qui se faisaient passer pour Alexis II : le basileus alla
jusqu’à négocier avec l’un d’eux, qui était protégé par le sultan d’Iconium et
qui avait repoussé une expédition envoyée contre lui. Son armée grossissait de
jour en jour et on désespérait de venir à bout de lui quand il fut assassiné
(1195-1196) .
Impuissant à faire régner l’ordre à
l’intérieur, le pouvoir impérial n’a plus aucune force de résistance, aucun
prestige à l’extérieur. L’Empire est devenu un pays passif : son armée,
composée entièrement de mercenaires étrangers, Allemands, Hongrois, Turcs, Varanges,
Bulgares, n’a plus que des effectifs réduits et mal payés, toujours prêts à
trahir et il n’y a plus de flotte de guerre. L’histoire de ces neuf dernières
années est celle des démembrements progressifs du territoire byzantin et des
désastres précurseurs de la conquête totale. En Asie Mineure la population
hellénique reculait devant les progrès des Turcs. En 1197 l’émir d’Angora,
Maçoûd, s’emparait de Dadibra en Paphlagonie, en expulsait les habitants et y
établissait des Turcs à leur place . L’année suivante, le
sultan d’Iconium, Kaï-Khosrou, ayant fait saisir deux chevaux arabes envoyés à
Alexis III par Saladin, le basileus fit emprisonner les marchands turcs ou
grecs qui commerçaient avec Iconium et laissa piller leurs fondouks : le
sultan riposta en ravageant la vallée du Méandre sans rencontrer aucune force
impériale . Trois grandes menaces
surtout planaient sur l’Empire : les progrès de l’État vlacho-bulgare,
l’hostilité des républiques italiennes, la politique de croisade de Henri VI.
La reconstitution d’un État bulgare dans lequel prédominait l’élément valaque était, comme trois siècles plus tôt, un danger permanent pour Constantinople. Les Asên, qui ne dissimulaient pas leurs ambitions, avaient rejeté les propositions de paix d’Alexis III à son avènement et mis en déroute l’armée du sébastocrator Isaac, gendre du basileus, près d’Amphipolis . Mais une crise intérieure faillit arrêter le développement du jeune État. Le sébastocrator, fait prisonnier, parvint à gagner un boyard influent, Ivanko qui assassina Jean Asên et s’empara de Tirnovo où Pierre Asên l’assiégea . Alexis III fit deux tentatives pour secourir Ivanko, mais deux fois, arrivée au pied des Balkans, l’armée refusa d’aller plus loin et il fallut rentrer à Constantinople. Ivanko, sur le point de succomber, s’échappa et rejoignit le basileus, qui le nomma gouverneur de Philippopoli (1196) . Un autre boyard, Dobromir Strez (le Chrysos de Nicétas), jaloux des Asên, passa au service de l’Empire avec 500 guerriers et devint gouverneur de Stroumnitza en Macédoine (1198) . L’inconvénient de cette politique, la seule
d’ailleurs qui fût à la portée d’Alexis, était le peu de garanties qu’offraient
ces chefs bulgares chargés de repousser leurs compatriotes. A peine installé à
Stroumnitza, Dobromir se déclara indépendant et empiéta sur les territoires
voisins. Après une expédition contre lui sans résultat, Alexis le maria à l’une
de ses cousines et lui céda la Haute Macédoine en fief (1199) . A plus forte raison
les Comans purent sans être inquiétés envahir la Thrace et la ravager deux
années de suite (1199-1200) et ils auraient marché sur Constantinople sans la
diversion du prince russe de Halicz en Galicie qui leur infligea une grande
défaite . Enfin en mars 1200 Ivanko,
qui avait enrôlé de nombreux Bulgares et congédié les troupes impériales, se révolta
à son tour et extermina l’armée envoyée contre lui : Alexis n’en vint à
bout que par la trahison. Après l’avoir attiré dans une entrevue et lui avoir
fait les plus belles promesses, il le fit arrêter et emprisonner à
Constantinople .
Puis, après le meurtre de Jean Asên, Pierre
avait associé au pouvoir son plus jeune frère, Johannitsa, surnommé plus tard
Kaloïan (Jean le Bon), qui avait été otage à Constantinople sous le règne
d’Isaac et en avait rapporté une haine vigoureuse contre les Grecs. Seul maître
du pouvoir après la mort de Pierre, il expulsa Dobromir de sa principauté du
Haut Vardar et envahit l’Empire. Le samedi saint 23 mars 1201, il prit d’assaut
le port de Varna, en abattit les murailles et en écrasa la population sous les
décombres. Alexis III n’eut d’autre ressource que de traiter avec lui et de lui
reconnaître la possession de toutes ses conquêtes . Intervenant ensuite
dans la guerre civile de Serbie entre les fils de Nemanja, Kaloïan s’empara de
Nisch, Belgrade et Braničeno (1204) .
Au moment où l’Empire s’effondrait, une
nouvelle puissance militaire naissait dans les Balkans et, pour soustraire son
pays à toute influence byzantine, Kaloïan négociait avec Innocent III : le
7 novembre 2204 un légat pontifical sacrait un patriarche de Bulgarie et lui
conférait le pallium ; le lendemain Kaloïan était couronné tsar dans la cathédrale
de Tirnovo avec la couronne envoyée par le pape .
L’empire et les républiques italiennes. — Au
démembrement territorial se joignirent les incursions des corsaires italiens au
moment où l’Empire n’avait plus de marine de guerre, et les maladresses de la
diplomatie impériale firent de Venise une ennemie irréductible de Byzance.
L’alliance avec Venise, fondement de la diplomatie d’Alexis Ier,
était compromise depuis Manuel, et les autres Italiens étaient toujours sous
l’impression des massacres de 1182 qui avaient failli se renouveler en 1187
après la révolte d’Alexis Branas . Cependant à la veille
de la croisade de Barberousse, Isaac l’Ange avait recherché l’alliance de
Venise, Gênes, Raguse et leur avait octroyé de nouveaux privilèges ; mais des
conflits n’avaient pas tardé à éclater à la suite des pirateries auxquelles se
livraient les sujets de ces républiques, qui profitaient de la situation
troublée de l’Empire pour écumer ses côtes, comme le Génois Guglielmo Grasso,
qui captura en 1192 l’ambassade envoyée par Saladin à Isaac l’Ange , ou les Pisans qui
attaquaient les navires grecs devant Abydos en 1194 .
La situation devint telle que, sous Alexis
III, le gouvernement impérial s’entendit avec certains pirates, qui épargnaient
les navires grecs ou alliés et venaient vendre leurs prises à Constantinople,
comme le Génois Gafforio qui se brouilla avec le mégaduc parce qu’il levait sur
lui de trop gros péages et qui, pour se venger, alla piller le port
d’Adramyttion sans être inquiété, mit en déroute un pirate calabrais au service
de l’Empire, envoyé contre lui, captura une flotte ancrée à Sestos pendant que
les matelots étaient à terre et mit les populations des côtes en coupe réglée
(1198). Alexis finit par négocier avec lui, mais, l’accord conclu, le fit
attaquer par une escadre de Pisans qui capturèrent ses navires et le mirent à
mort .
Par représailles, le basileus eut la malencontreuse idée de faire occuper par
des mercenaires allemands un palais appartenant à la colonie génoise de
Constantinople . Il s’ensuivit une
brouille avec Gênes, qui fit saisir un port crétois et attaquer par un corsaire
Corfou, qui venait d’être restituée à l’Empire . Alexis ouvrit des
négociations (mars 1199) qui aboutirent à une
réconciliation et à la restitution à la colonie génoise de tout ce qui lui
avait appartenu (traité du 12 octobre 1201) .
Plus que jamais l’empereur prenait des
pirates génois à son service et allait même jusqu’à partager leurs
bénéfices , ce qui lui valut un
conflit avec le sultan d’Iconium, dont les navires appartenant à ses sujets
avaient été pillés dans la mer Noire . D’autre part la
réconciliation de l’Empire avec Gênes et les faveurs accordées aux Génois eurent
pour résultat de brouiller Venise avec Alexis III. Au début de son règne le
basileus avait reçu une ambassade du doge Henri Dandolo, qui lui demandait de
renouveler les traités ; mais il fallut trois ans de négociations pénibles
pour aboutir à l’accord de novembre 1198 , qu’Alexis III ne tarda
pas à violer ouvertement en encourageant les Pisans à attaquer Venise et en
chargeant la colonie vénitienne d’impôts. On comprend que Venise, voyant sa
situation dans l’Empire menacée par Pise et Gênes, ait saisi l’occasion qui se
présenta bientôt de renverser Alexis III et de le remplacer par un souverain attaché
à ses intérêts .
Henri VI contre Byzance. — Mais une
menace plus immédiate avait failli avancer de plusieurs années la croisade
contre Byzance. Le mariage entre Constance de Sicile, héritière légitime de
Guillaume II, avec Henri, roi des Romains, fils aîné de Barberousse, avait été
célébré à Milan le 27 janvier 1186 , mais à la mort de
Guillaume II (18 novembre 1189), ce fut un bâtard de Roger II, Tancrède de
Lecce, qui fut proclamé roi .
Décidé à faire valoir les droits de
Constance, Henri envahit l’Italie normande, mais sa première expédition échoua
devant Naples, dont il ne put s’emparer (août 1191) et ce fut seulement
après la mort de Tancrède (février 1194), qui ne laissait comme héritier qu’un
enfant de 3 ans , qu’il put se rendre maître
des Deux-Siciles . Devenu ainsi le plus
puissant souverain de la chrétienté, tout le poussait à la conquête de
Byzance : la tradition des rois normands ses prédécesseurs et la volonté
de son père, dont l’expédition avait démontré que l’Empire byzantin était le
principal obstacle à la croisade. Après avoir organisé son nouveau royaume et
envoyé tous les survivants de la famille royale en Allemagne , il somma Isaac l’Ange
de lui restituer les territoires conquis en Macédoine par Guillaume II, puis,
apprenant que son trône était menacé, il fit alliance avec lui et maria la
fille du basileus, Irène Ange, veuve à 16 ans du fils aîné de Tancrède, à son
frère Philippe, duc de Souabe, se ménageant ainsi des prétextes
d’intervention .
Mais par-delà Byzance l’ambition d’Henri VI
s’étendait à l’Orient chrétien et il entendait bien se servir de la croisade
pour y établir sa suprématie. Le 31 mai 1195 il prenait la croix à Bari et
allait ensuite en Allemagne faire prêcher la croisade . Avant de partir
lui-même, il envoya deux armées en Palestine, l’une par mer, l’autre sous le commandement
de l’archevêque de Mayence par la voie terrestre de l’Europe centrale et
Constantinople : Alexis III n’était pas en état de s’opposer à cette
nouvelle traversée de l’Empire par les croisés et leur prêta même des navires
pour les transporter directement à Antioche . Les circonstances
semblaient favoriser les projets d’Henri VI. Pendant qu’il préparait sa
croisade, il reçut une ambassade d’Amaury de Lusignan, devenu souverain de
Chypre, qui lui demandait une couronne royale (octobre 1195). Peu après arriva
une demande analogue de Léon II, seigneur de la Petite Arménie. Henri VI
accueillit avec joie ces demandes, preuves du prestige qu’il avait déjà en
Orient, et s’empressa d’y satisfaire. Amaury fut couronné dans la cathédrale de
Nicosie, en présence du chancelier d’Empire Conrad et d’un légat du pape
(septembre 1197) ; Léon II reçut le même honneur à Tarse le 6 janvier
1198 .
Mais l’objet principal des préoccupations
d’Henri VI était l’attaque de l’Empire byzantin et, pour affaiblir le moral de
son adversaire, il envoya à Alexis III, sans doute à la fin de 1196, un
ultimatum par lequel il exigeait l’envoi d’une armée grecque en Palestine, pour
secourir la croisade allemande, et le paiement de fortes indemnités de guerre
sous la forme d’un tribut annuel de 5 000 livres d’or. Jamais l’Empire
n’avait été humilié à ce point. Alexis envoya à Palerme le Préfet de la Ville
Eumathios Phulokalos, qui obtint la réduction du tribut à 1 600 livres.
Cette somme dépassait encore de beaucoup les moyens du basileus, qui provoqua
un vrai soulèvement en établissant un impôt supplémentaire, l’ Ἀλαμανικόν,
et en saisissant les trésors d’églises . L’anxiété était grande
à Constantinople quand arriva la nouvelle inattendue que Henri VI était mort à
Messine le 28 septembre 1197, à la veille de son embarquement pour la croisade . Constantinople était
sauvée mais le plan d’Henri VI n’allait pas tarder à être repris.
La croisade de Constantinople. — Lothaire de
Segni, élu à la papauté le 8 janvier 1198 , replaça Rome sous le
pouvoir pontifical, chassa les Allemands de l’Italie centrale, rétablit l’autorité
du Saint-Siège sur le royaume de Sicile en prenant sous sa tutelle le jeune
fils d’Henri VI, Frédéric Roger, et prêcha la croisade aux Lieux saints . L’avènement de ce pape
eut pour résultat l’effondrement de la politique gibeline d’Henri VI en Orient
comme en Occident, et Alexis III y vit l’espoir d’échapper à une croisade
germanique contre Byzance. Le frère d’Henri VI, Philippe de Souabe, candidat à
l’Empire, n’était-il pas devenu par son mariage le gendre d’Isaac l’Ange, le
beau-frère de son fils Alexis, qui avait pu s’échapper de Constantinople et se
réfugier en Sicile ? Et sa sœur, qui l’avait reconnu, ne cessait
d’exhorter son époux à replacer Isaac et son fils sur le trône de Byzance .
C’est ce qui explique les efforts d’Alexis
III pour gagner à sa cause le nouveau pape, qui avait les mêmes ennemis que lui
et cherchait à écarter Philippe de Souabe de l’Empire en favorisant son rival,
Otton de Brunswick .
De 1198 à 1202 une correspondance active
s’établit entre Alexis l’Ange et Innocent III. Aux offres d’alliance du
basileus le pape répondait en exigeant
d’abord l’union des Églises et, mal renseigné sur l’état misérable de l’Empire,
la conduite par Alexis d’une croisade en Palestine . Le malentendu entre
les deux interlocuteurs ne tarda pas à se manifester : Alexis s’en
remettait à la Providence pour délivrer Jérusalem et ne voyait d’autre moyen
d’unir les Églises que la convocation d’un concile œcuménique à Constantinople.
Une réponse du patriarche attaquant les prétentions de Rome à la primauté ne
pouvait que rendre tout accord impossible . L’échange de lettres
continua sans aucun résultat jusqu’en 1202 , mais il était déjà
trop tard pour arrêter le cours des événements.
En effet l’appel d’Innocent III avait été
entendu, en particulier en France et en Allemagne , mais cette fois les
souverains, occupés par leurs querelles, ne prirent pas la croix et, comme en
1095, la croisade fut dirigée par des comtes et de simples seigneurs qui, pour
éviter la longue route de terre et le passage par l’Empire byzantin, conclurent
un contrat avec Venise qui s’engagea à les transporter par mer en Égypte, qu’il
fallait d’abord conquérir avant de pouvoir reprendre Jérusalem . Rien n’était plus
normal jusque-là, quand une série de démarches et d’événements firent envisager
la question d’une déviation possible de la croisade : la visite du jeune
Alexis au pape, qu’il essaya d’apitoyer sur son sort ; l’élection de
Boniface de Montferrat comme chef de la croisade (14 septembre 1201) et son entrevue
avec Philippe de Souabe à Haguenau le 25 décembre suivant ; la tentative
inutile de Boniface pour gagner le pape à ses plans de restauration d’Isaac
l’Ange et de son fils ; les
sollicitations dont les croisés arrivés à Venise, en juin 1202, furent l’objet
de la part de Philippe de Souabe et du prétendant ; enfin
l’impossibilité où se trouvèrent les croisés d’acquitter les sommes dues aux
Vénitiens d’après leur contrat .
Ce fut alors que le pas décisif fut franchi
et que les Vénitiens, en commerçants avisés, imposèrent aux croisés, pour être
déchargés de leur dette, l’attaque de Zara révoltée contre eux et que quatre
expéditions n’avaient pu soumettre (octobre 1202) . Bien qu’officiellement
la croisade dût, après la prise de Zara, reprendre le chemin de l’Égypte, on a
des raisons de croire que sa déviation sur Constantinople était déjà décidée
dans les conseils des grands chefs : c’est ce que prouve l’envoi à Rome,
avant le départ de Zara, du légat de la croisade, Pierre, archevêque de Capoue,
chargé de demander au pape d’approuver la restauration du prétendant et d’Isaac
l’Ange . C’est ce qui ressort
surtout de la rapidité avec laquelle les événements se sont précipités.
Les premières sollicitations d’Alexis le
jeune aux croisés par l’intermédiaire de Boniface de Montferrat remontent en
effet au mois d’août 1202 . Peu après le pape fait
défendre aux croisés d’attaquer toute terre chrétienne sous peine
d’excommunication et, malgré cette défense, les croisés lèvent l’ancre le 8
octobre . Après la prise de Zara
(12 novembre) a lieu l’envoi du légat à Rome (novembre), puis Boniface de
Montferrat, resté en Italie par ordre du pape , vient prendre le
commandement de l’armée ; et peu après arrivent au camp des messagers de
Philippe de Souabe et du prétendant avec lesquels le doge et les hauts barons,
après de nombreuses discussions, concluent le traité par lequel ils s’engagent
à restaurer Alexis, qui de son côté promet d’accepter l’obédience de Rome, de
défrayer les croisés de leurs dépenses, de les aider à conquérir la Terre
Sainte et d’entretenir sa vie durant 500 chevaliers en Palestine (janvier
1203) . Innocent III, qui
avait d’abord fulminé contre la prise de Zara, consent, à la demande des
croisés, à leur donner l’absolution (février) . A ce moment, malgré la
défection d’une partie de l’armée, l’expédition contre Constantinople était décidée.
Le 7 avril Alexis l’Ange arrivait à Zara et était accueilli avec
enthousiasme , et, après une escale
de trois semaines à Corfou, le 24 mai la croisade faisait voile vers
Constantinople . Innocent III, averti
trop tard par le légat, écrivait une lettre impérative aux croisés pour leur
défendre d’attaquer la terre des Grecs .
On sait quelles nombreuses discussions a
soulevées le départ des responsabilités dans cette déviation de la
croisade . En l’absence de
documents d’archives qui nous renseigneraient sur les négociations secrètes,
c’est la seule succession des événements qui permet d’étayer une hypothèse.
L’initiative du projet d’attaque de l’Empire byzantin revient sans conteste à
Philippe de Souabe, qui, désireux d’accomplir les desseins d’Henri VI sur
l’Orient, mais retenu en Allemagne par sa lutte contre Otton IV, a vu dans la
croisade un moyen inespéré d’établir son protectorat sur Constantinople en
faisant valoir les droits d’Isaac l’Ange et de son fils ; dans cette
entreprise Boniface de Montferrat fut son principal instrument, mais on ne
saura jamais quelle part Philippe put prendre à son élection comme chef de la
croisade.
D’autre part Venise, dépossédée de sa
situation dans l’Empire au profit de Gênes, devait avoir aussi son plan de
revanche. Ce qu’elle voulait, c’était voir sur le trône de Constantinople un
empereur qui fût sa créature, qui lui permît d’exploiter l’Empire à son gré en
lui accordant des bases navales, des entrepôts, des privilèges, tout ce que
sous le régime turc on devait appeler des capitulations. La croisade ne fut
pour elle qu’un moyen d’arriver à ses fins et elle accueillit avec empressement
les ouvertures de Philippe de Souabe et d’Alexis. La diversion sur Zara ne fut
qu’une première expérience du concours qu’elle pouvait attendre des croisés et
il est assez remarquable que, pour cette expédition contre une ville
chrétienne, le doge et les nobles vénitiens aient pris la croix et qu’après la prise de
Zara ils n’aient pas demandé l’absolution au pape et soient restés
excommuniés , enfin que dans le
conseil des chefs, suivant Robert de Clan, le doge Henri Dandolo ait été un des
plus ardents à soutenir la nécessité de l’accord avec Alexis .
Mais la grandeur des événements allait
dépasser et les prévisions du pape et les ambitions elles-mêmes des croisés.
Alexis III, démuni de troupes, ne put même pas tenir un mois devant les assauts
des Francs et des Vénitiens (23 juin-17 juillet 1203) et s’enfuit honteusement
sur un navire en emportant son trésor ; Constantinople, qui avait résisté
à tous ses ennemis depuis la construction des murailles de Théodose II, tombait
au pouvoir des Occidentaux, Isaac l’Ange était rétabli sur le trône et son fils
associé à l’Empire (1er août). Mais la joie qui suivit cette
victoire fut de courte durée. Le nouvel empereur ne put tenir qu’une partie de
ses engagements pécuniaires et dut demander un délai pour le départ de la
croisade, fixé à la Saint-Michel. Pendant qu’il s’emparait des villes et des
forteresses de Thrace, des rixes eurent lieu entre les Grecs et les croisés qui
incendièrent une partie de la ville. A son retour (11 novembre) Alexis IV,
pressé par les barons de tenir ses promesses, se déroba. Les haines
s’exaspéraient chaque jour entre les croisés et les Grecs, qui essayèrent
d’incendier la flotte vénitienne. Le 5 février 1204 un parent éloigné des
empereurs, Alexis Doukas dit Murzuphle , excita une émeute, se
fit proclamer empereur lui-même, réintégra Isaac dans sa prison où il mourut,
fit étrangler Alexis IV et mettre les fortifications de la ville en état de
défense. Un second siège de Constantinople était nécessaire, mais cette fois il
ne s’agissait plus d’établir sur le trône de Byzance un membre de la dynastie
légitime : par le traité signé en mars entre la république de Venise et
les croisés, un partage équitable était prévu, partage du butin, de la ville et
de l’Empire ; un collège formé de 6 Vénitiens et de 6 Français élirait un
empereur ; Venise se réservait l’église Sainte-Sophie et l’élection du
patriarche.
Ce traité, d’où est sortie l’organisation
de l’Empire latin, n’allait pas tarder à être exécuté ; il fallut 3 jours
aux croisés pour reprendre Constantinople (9-12 avril), mais un pillage éhonté
suivit la victoire, et le mai suivant le comte de Flandre Baudouin était
proclamé empereur. Byzance avait cessé de vivre, mais la croisade n’avait fait
que porter le dernier coup à un État atteint depuis longtemps dans ses sources
vitales .
LIVRE TROISIÉME. AGONIE ET MORT DE BYZANCECHAPITRE PREMIER. — La dernière
renaissance et son échec (1204-1389)
|
